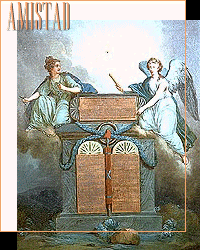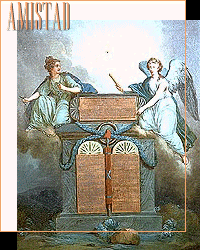
Courrier
Visionné le 17.12.97, Montréal Loews
Le site Amistad
|
Noir et Blanc
C'est un acte de courage, et la douleur sur un visage, qui ouvre le nouveau film de Steven Spielberg. En quelques plans très saccadés, Spielberg fait monter l'adrenalyne, excite le spectateur, puis le choque avec une mutinerie sanglante, mais d'époque.
La détermination dirige le destin du héros, Sengbe (Cinque), comme le montage de Steven Spielberg.
Amistad livre un scénario classique, purement américain dans ses rebondissements, incluant un flash back sur le "Passage du milieu" en plein milieu du film. Et comme un bateau qui traverse l'océan, il subit des tempêtes, magnifiques, des instant de grâce, et puis des moments sans vent, plats.
La frustration provient de cette alternance, de ce déséquilibre, entre un Spielberg visuellement très inspiré sur des scènes splendides et un Spielberg filmant sans profondeur des images ternes.
Le film atteint cependant son but: le message est compris, acquis, appris.
Après un holocauste en noir et blanc (La liste de Schindler), le cinéaste s'intéresse à la traite des noirs par les blancs. Une traite sauvage, bestiale, atroce, répugnante, cruelle. Filmée sans concession, sans pudeur, sans hypocrisie. Les Africains sont battus, affamés, violés, nus, humiliés.
Le film achève son réalisme avec le mélange des langues: mende, espagnol, américain. La communication est au coeur de l'intrigue. Chacun défendant ses intérêts, ses ambitions.
Mais Amistad pêche aussi par son didactisme. Cette lourdeur semée au gré des procès, cette analyse de la chrétienté assez superflue. La partie "américaine" du film est assurément la plus baclée. On n'en retient aucune force.
Le réalisateur est piégé par sa volonté de vouloir tout montrer, tout dire. Il n'évite pas les hourrahs et le symphonique pompeux d'une victoire juridique, ni les plans inutiles autour de procès déjà vus, ou une conclusion narrative un peu trop facile.
De même, il ne va pas assez loin dans sa critique du système politique, dont la corruption. On imagine ce qu'un Scorcese aurait pointé du doigt...
Heureusement, Amistad c'est avant tout une histoire de Noirs. Parmi les scènes mémorables, on notera toute l'ouverture (20 minutes) qui va de la mutinerie à l'emprisonnement des Africains. A la fois terrifiante et angoissante, cette ouverture se ponctue d'un carnage, d'une errance (fantômatique et sublime), et d'une fuite. Cette fuite, celle de Sengbe à la nage, essoufflé, attiré par les abysses, est un grand moment visuel.
Il montre toute la maestria technique de ce film. Une perfection constante, de la lumière aux décors en passant par les costumes...
La traversée du bateau-négrier appartient aussi à ces souvenirs de cinéma inoubliables. Spielberg prouve sa passion pour cette histoire. Une passion qu'il filme inégalement mais utilement.
Le cinéaste réussit aussi sa description d'une Espagne dorée et déclinante, d'une Amérique démocratique et religieuse, sa prise de position en faveur des Africains.
A la croisée de ses opus épiques (La Couleur pourpre, L'empire du soleil, La liste de Schindler), Amistad démontre surtout la maturité du cinéma de Spielberg.
Malgré les faiblesses (la paresse?), grâce à un scénario habile et une histoire passionnante, l'oeuvre est bien supérieure à la qualité habituelle hollywoodienne.
Dommage qu'il n'ait pas voulu dépasser Grisham dans le premier procès.
Ce procès est porté par l'insipide Matthew McConaughey. Il contraste fortement avec celui de la Cour Suprême, monologue final de 11 minutes, sans musique, sobre, et interprété par un Anthony Hopkins impeccable.
Hopkins nous éblouit aussi lors d'une autre scène où son esprit distrait bataille entre sa plante et les arguments anti-abolitionnistes. Parmi ceux-ci, Morgan Freeman. La star ne brille pas avec un jeu très original. Excepté lorsqu'il fouille la cale du négrier où il expose des bribes de son talent.
En tête de liste, il y a celui qui souffle la force de ce film, son message, son envie de liberté, Djimou Hounsou.
A la fois rebelle et guide, personnage central et cause idéaliste, il est une révélation mais surtout un emblême. Hounsou transmet ses émotions avec justesse dans chaque scène.
Sa beauté et sa puissance, son charisme en un mot, permet à Amistad de s'élever au dessus d'un simple exposé sur l'esclavage et la justice.
Voilà donc une oeuvre qui révolte, qui éclaire - et pas seulement un pan de l'Histoire - et un film de Steven Spielberg qui pardonne l'impair de The Lost World.
Amistad n'instruit pas réellement, ne faisant que répliquer l'Histoire. Il s'agit avant tout d'un plaisir cinématographique. Un divertissement intelligent.
|