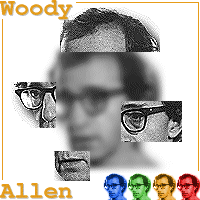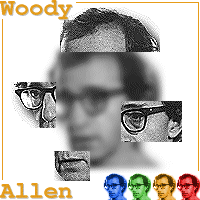|
Deconstructing Allen
- axel février 2003
Allan Stewart Konigsberg né à Flatbush, un faubourg de Brooklyn, le 1er Décembre 1935.
A l’école, le petit Allan est introverti. Il passe des heures dans sa chambre où il perfectionne ses tours de magie et joue de la clarinette. Le jazz l’enthousiasmera d’ailleurs tout au long de sa vie, comme en témoigne Wild Man Blues (1997), le documentaire de Barbara Kopple.
Dès l'âge de 15 ans, Woody envoie des histoires drôles aux rubriques humoristiques des journaux new-yorkais. Ceci lui permet de se faire remarquer par une agence de relations publiques avec laquelle il signe un contrat de cinquante histoires drôles par semaine, pour 25$. Le jeune Woody se sent alors en plein milieu du show-business. Ses parents, déçus, car il l'imaginaient plutôt médecin ou épicier, le poussent à démissionner. Woody Allen va alors être embauché à la NBC, pour 175$ par semaine.
Après des années passées à écrire des gags pour d’autres comiques, Woody Allen commence à se produire sur scène en 1961, détournant sa timidité naturelle en moteur comique. Il fait du stand-up tristement pince-sans-rire et ponctue souvent ses fins de phrase par des tics à la limite du renvoi gastrique. Allen semble ne pas être particulièrement fière de cette période qui ne figure pratiquement pas dans son ¦uvre.
Son premier boulot au cinéma, en tant que scénariste et acteur dans What’s New Pussycat, en 1965, le propulse immédiatement parmi les demi-icones des swinging-sixties.
Lancé, Woody Allen remonte What’s up, Tiger Lily ? (Lily la tigresse) en 1966, un film d'espionnage japonais, en le commentant et en l'augmentant de quelques séquences. C'est son premier long métrage. Il enchaîne, en 1969, avec une comédie, Take the Money and Run (Prends l’oseille et tire-toi).
En tant que comédien, réalisateur et scénariste, Woody Allen se tourne d'abord vers la satire et le burlesque (jusqu'à Love and Death, Guerre et amour, en 1975). Le grand public voit en lui un petit bonhomme à lunettes d'une épouvantable maladresse. Toutefois, celui-ci se dévoile par le biais d’¦uvres autobiographiques aux sujets plus graves mais non dénuées d'humour : Annie Hall (1977), Interiors (Intérieurs, 1978), fortement inspiré par Ingmar Bergman , et Manhattan (1979).
On ne peut pas parler de maniérisme pour Woody Allen mais son ¦uvre, marquée par le doute, est jalonnée de références formelles. Durant les années 80, le comédien-cinéaste puise son inspiration chez Shakespeare pour Midsummer Night’s Sex Comedy (Comédie érotique d’une nuit d’été, 1982), Pirandello pour The Purple Rose of Cairo (La rose pourpre du Caire, 1985), Tchekhov pour Hannah and her sisters (Hannah et ses s¦urs, 1986), et Kafka pour Shadows and fog (Ombres et brouillard, 1991).
Allen fut marié à Louise Lasser puis il eut une longue relation avec Diane Keaton et avec Mia Farrow qui apparaît dans pratiquement tous ses films des années 80. Mia et Woody eurent un fils puis firent les gros titres des journaux à scandales, en 1992, lorsqu’il dut admettre sa liaison avec la fille adoptive de Mia, Soon-Yi Previn.
Dans les années quatre-vingt dix, marqué par la séparation avec Mia Farrow et le scandale qui a suivi, il dirige de jeunes stars hollywoodiennes comme John Cusack (Bullets Over Broadway, Coups de feu sur Broadway en 1994), Mira Sorvino (Mighty Aphrodite, Maudite Aphrodite en 1995), Edward Norton (Everyone says I love you, Tout le monde dit I love you en 1996) ou encore Winona Ryder et Leonardo DiCaprio (Celebrity en 1998). A partir de 2000, Woody Allen revient à ses premières amours en dirigeant trois comédies dans lesquelles il joue le rôle principal : Small time crooks (Escrocs mais pas trop, 2000), son plus gros succès au box-office américain, The Curse of the Jade scorpion (Le sortilège du scorpion de Jade, en 2001) et Hollywood Ending en 2002.
La tendance qu’à Woody Allen de faire de son ¦uvre une large autobiographie composite est surévaluée. Sa vie y est, somme toute, abordée de façon assez superficielle. Il fait preuve d’une certaine impudeur lorsqu’il partage ses états d’âme avec le spectateur mais il ne s’agit pas, à proprement parler, du spectacle de sa vie.
Je suis abasourdi par le nombre de personnes qui veulent " connaître " l’univers alors qu’il est déjà suffisamment difficile de se repérer dans Chinatown.
Le New York de Woody Allen nous parle.
Nous sommes les oreilles de ces mûrs bâtis, en premier lieu, sur la palabre et la négociation indienne, hollandaise, anglaise... Les mots croisent le fer, les paroles sont coupées mais ininterrompues. Rarement, un silence réveille l’¦il qui écoutait. Pourtant, il faut regarder Manhattan, ce conte vertical à la touchante photo noire et blanche. Son architecture donne à voir l’entrecroisement naturel des hommes et des choses dans cette ville-monde, centre de tout. Parmi ces lignes reliant les continents, Mariel Hemingway, la petite fille d’Ernest, vient nous rappeler que tout cela se passe en Amérique.
Ce New York nous parle parce qu’il est humain. Féminin plutôt. La ville nous est donnée par elles, les épouses (Maris et femmes), les s¦urs (Hannah et ses s¦urs), les ex-femmes (Manhattan), les amies (Meurtre mystérieux à Manhattan) ou par Mia Farrow, vraie héroïne de trois films (La rose pourpre du Caire, 1985, September, 1987, Alice, 1990). Elles sont innombrables mais toujours volubiles. Les hommes, adjuvants, sont souvent balourds et stéréotypés (à voir, en particulier, le fantomatique Alan Alda qui apparaît dans trois films).
En somme, ce rêve new-yorkais est une tentative poétique de restituer l’atmosphère onirique ou luxuriante du Manhattan de son enfance que l’on découvre dans Radio Days.
La célébrité m’a apporté un gros avantage : les femmes qui me disent non sont plus belles qu’autrefois.
Les films de Woody Allen font souvent preuve d’une grande tendresse fraternelle pour les femmes. Hannah et ses s¦urs est un film protecteur dans lequel le désespoir du personnage de Woody dénote avec les aventures plus ou moins légères mais rarement névrotiques des protagonistes féminins. Dans Maudite Aphrodite, il se fait même ange-gardien d’une prostituée pas très perspicace (Mira Sorvino).
Cependant, Woody Allen parvient, parfois, non sans quelques détours, à assumer la vanité qui meut ses désirs. La vanité formelle d’un Stardust Memories, dont l’esthétique nouvelle vague copie à vide les premiers Godard, est exemplaire.
Il prend plaisir à exhiber les plus belles femmes à son bras, de ses premières comédies (sa première femme Louise Lasser dans Bananas) aux plus récentes (Le mystère du scorpion de Jade avec Charlize Theron). Cette vanité sociale s’exprime directement, quoiqu’à travers Kenneth Branagh, un acteur-doublure de lui-même, dans Celebrity qui dénonce et repend dans un même mouvement glamour son affection pour les petits plaisirs du show-business.
Nous vivons dans une société trop permissive. Jamais encore la pornographie ne s'était étalée avec une telle impudeur. Et en plus, les films sont flous !
Woody Allen fait souvent état, sans trop de pudeur, de son obsession sexuelle caractérisée. Qu’il le formule oralement (Bananas), qu’on le lui " formule " oralement (Maudite Aphrodite, Harry dans Tous ses Etats) ou qu’il en fasse une ¦uvre comme dans Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, il se plait à illustrer sous des formes les plus diverses cette déclaration : " Mon cerveau ? C’est mon second organe préféré ".
J’ai des questions à toutes vos réponses.
Il faut dire qu’il arrive à Woody Allen de penser avec son sexe et de jouir avec son cerveau. Son cerveau, justement, machine démontée dans Harry dans tous ses états, révèle une tendance névrotique à être son propre objet de contemplation. Toujours en analyse, à l’écoute de lui même, le pauvre Woody se trouve parfois taxé d’égoïsme dans ses film aux personnages multiples, peut être les plus dépressifs (Hannah, Tout le monde dit I Love YouŠ). De la fameuse hypocondrie aux diverses phobies, ses nombreuses névroses, tournées au ridicule sont un vecteur comique intarissable.
Plus fondamentalement, le doute et l’insatisfaction chronique sont la condition de son humour. Dans Annie Hall, son premier film non burlesque, le " personnage " qu’il interprète finit par ce fragment d’humour juif (qu’il a en fait contribué à établir) : une femme dans un café, estimant la tarte aux myrtilles qu’elle a commandé, s’indigne auprès du serveur : " Elle n’est pas bonne votre tarte et en plus elle est trop petite ". C’est, en fait, un exemple frappant de la logique de l’humour allenien, toujours en contradiction, jamais content, poussant l’art du paradoxe jusqu’à l’absurde.
Je ne veux pas atteindre l’immortalité grâce à mon ¦uvre. Je veux atteindre l’immortalité en ne mourant pas.
L’absurde justement comme vision brechtienne de l’existence ou comme manière salutaire d’échapper à cette névrose morbide qui le perturbe tant ? Arrêtons là cette analyse facile. L’absurde est un héritage de l’éducation cinématographique acquise à travers ses idoles, les Marx brothers. Les névroses de Woody, prises aux sérieux, perdent leur intérêt humain et prennent des allures métaphysiques qui desservent ses films " bergmaniens " comme Intérieurs ou September.
Les cinq premières comédies burlesques de Woody Allen couvrent à elles seules tous ses thèmes importants en les tournant en dérision. Prends l’oseille et tire toi aborde le désir de richesse, Bananas et Woody et les robots, l’engagement politique, Tout ce que vous..., le sexe, Guerre et Amour, le courage et l’amour.
J'ignorais totalement qu'Hitler fût un nazi. Pendant des années, j'ai cru qu'il travaillait pour la compagnie des téléphones.
Lorsque Woody Allen reste léger, le charme agit et l’écoute est sans doute plus importante. Une fausse barbe et un accent espagnol mal imité suffisent à ridiculiser les dictateurs d’Amérique du Sud (Bananas) ; un faux documentaire sur un caméléon humain qui prend l’apparence de son entourage nous parle profondément du manque de liberté de notre société (Zelig) ; des cultures de légumes géants donnent à voir son inquiétant prolongement dans un futur, pour le moins, complexe (Woody et les robots).
Après des années d’analyse, Woody Allen semble s’être réveillé de son hypnose désespérée sous un feu d’artifice dans Le Mystère du Scorpion de Jade. Il y surpasse l’artifice de ses déclarations pseudo-optimistes et psychothérapeutiques d’un Tout le Monde dit I love You pour la naïveté tranquille d’un amour sincère.
|
|