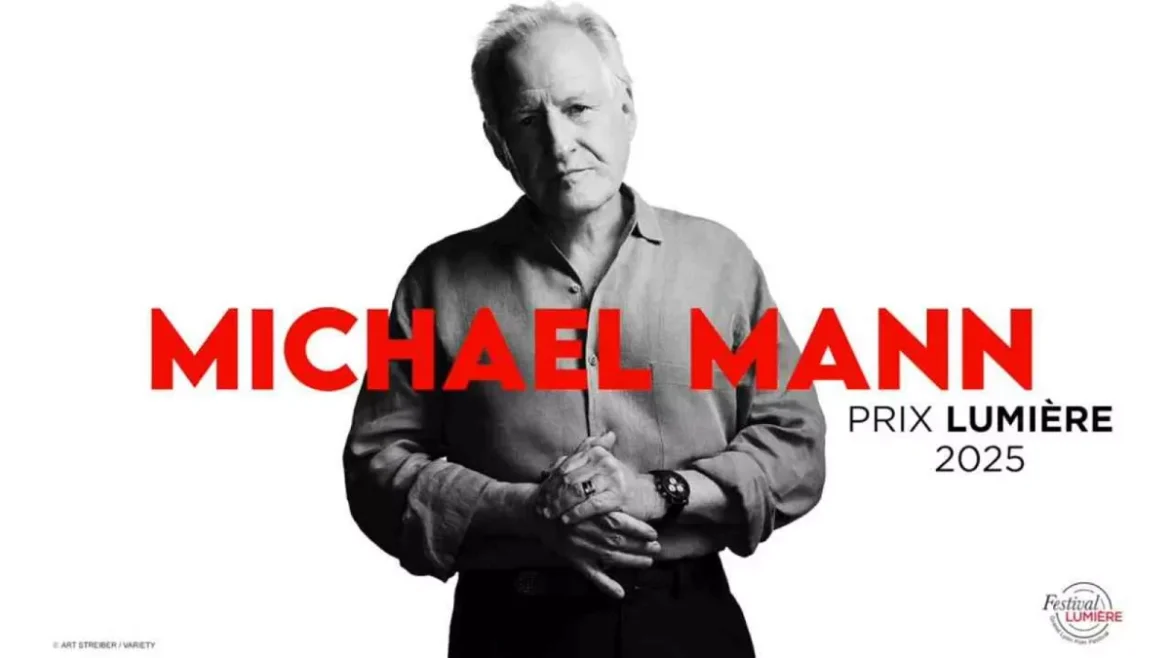Prix Lumière 2025, Michael Mann est un cinéaste américain à la fois singulier – presque indépendant -, et classique dans sa forme, même s’il s’inspire de l’école esthétique britannique des années 70-80 et reste marqué par l’influence du Nouvel Hollywood. Il a réalisé treize longs métrages, mais il a aussi produit des films comme The Aviator, Hancock, Le Mans 66, tout en travaillant pour la télévision (producteur de Deux flics à Miami, scénariste de Starsky et Hutch, créateur de Vegas).
Thief (Le Solitaire, 1981)
- Casting : James Caan, Tuesday Weld, Robert Prosky, Jim Belushi
- Scénario / adaptation : Michael Mann, d’après les mémoires The Home Invaders de Frank Hohimer
- Le Pitch : Frank, cambrioleur perfectionniste spécialisé dans les coffres-forts, rêve d’une vie rangée avec une femme et un enfant. Pour atteindre ce but, il accepte une association avec un caïd local, mais son désir d’indépendance l’entraîne vers une spirale fatale.
- Box-office France : 156 000 entrées
- C’est la première œuvre et c’est un manifeste : déjà l’architecture urbaine nocturne, agrémebrée par les pulsations électroniques de Tangerine Dream. Il dessine le portrait d’un professionnel obsédé par le contrôle (archétype qu’on retrouvera dans la plupart de ses films) mais condamné par la société qu’il veut fuir. Le film installe le motif mannien du « code » personnel face à un monde corrompu. Une thématique de la résistance à l’ordre établi qui traverse toute sa filmo. Ses anti-héros produisent des récits non binaires, où le flic peut respecter le voyou. La liberté est aisi toujours plus importante, quitte à se mettre hors-la-loi dans des systèmes oppressifs.
The Keep (La Forteresse noire, 1983)
- Casting : Scott Glenn, Ian McKellen, Jürgen Prochnow, Gabriel Byrne
- Scénario / adaptation : Michael Mann, d’après le roman de F. Paul Wilson
- Le Pitch : En 1941, dans un village roumain occupé, des nazis ouvrent une forteresse mystérieuse et libèrent une entité maléfique. Un professeur juif et un être surnaturel s’allient pour tenter de contrer la créature.
- Box-office France : 289 000 entrées
- Film maudit, mutilé au montage, mais assez fascinant. Micahel Mann transpose son esthétique nocturne et musicale dans un cadre gothique et mystique. On y perçoit déjà son intérêt pour la lutte entre forces contraires : lumière et ténèbres, humanité fragile et pouvoir destructeur. Une allégorie du mal absolu qui connaît de multiples avaries : décès du responsable des effets spéciaux, retards sur le tournage interminable, problèmes techniques, perfectionnisme du cinéaste, final cut assassiné par le studio… Au final, le film, plus kitsch qu’horrifique, s’approche du désastre. Reste une esthétique 80s remarquable, dont on voit bien le cousinage avec les frères Ridley et Tony Scott, Adrian Lyne et autres Alan Parker. Rappelons que Mann a étudié, comme eux, à la London International Film School.
Manhunter (Le Sixième Sens, 1986)
- Casting : William Petersen, Tom Noonan, Joan Allen, Brian Cox
- Scénario / adaptation : Michael Mann, d’après Dragon Rouge de Thomas Harris
- Le Pitch : Will Graham, profiler du FBI, reprend du service pour traquer un tueur en série surnommé la « Fée aux dents ». Ce travail l’expose à ses propres démons et à l’influence vénéneuse d’Hannibal Lecter, déjà emprisonné.
- Box-office France : 147 000 entrées
- C’est le premier film autour du cannibal psychopathe Hannibal Lecter. Cinq ans avant Le Silence des agneaux, Michael Mann s’empare de ce thriller best-seller. Sans doute à cause de l’approche trop glacée, esthétisante même, et un décorum qui écrase le récit, le film s’avère assez mineur. Reste une réflexion sur l’empathie et le danger de se projeter dans l’esprit du mal qui contamine les plus innocents. Mais du titre français repris par le succès phénomène de M. Night Shyamalan à l’acteur principal oublié, ce Sixième sens a été effacé dans tous ses recoins. Le silence des Agneaux de Jonathan Demme le met K.O définitivement, le surclassant dans tous les registres : interprétation, scénario et réalisation.
The Last of the Mohicans (Le Dernier des Mohicans, 1992)
- Casting : Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Wes Studi, Russell Means, Patrice Chéreau
- Scénario / adaptation : Michael Mann et Christopher Crowe, d’après James Fenimore Cooper et l’adaptation de 1936
- Le Pitch : En 1757, pendant la guerre de la Conquête, Hawkeye, fils adoptif des Mohicans, protège Cora et Alice Munro dans un territoire ravagé par les luttes entre Anglais, Français et nations amérindiennes. Amour, loyauté et tragédie se mêlent dans un monde en mutation.
- Box-office France : 1,24 million d’entrées
- C’est le premier grand succès populaire du réalisateur. Et la neuvième version de cette histoire aux airs de Tarzan ou de Mowgli. Mann se détourne du polar urbain pour explorer la nature sauvage et le choc des civilisations à travers une épopée romantique et presque mélancolique. Il en fait une histoire d’amour contrariée et une méditation sur la fin d’un monde. Le lyrisme visuel, les ruptures rythmiques du montage, et cette musique qui devait être électro pour devenir symphonique, confirment que Mann aiment expérimenter. Mais cette fois-ci le cinéaste démontre qu’il peut aussi séduire. Notons aussi qu’il s’agit du premier « hit » au box office de Daniel Day-Lewis, qui insuffle tout son génie et toute son énergie à cette traque cruelle.
Heat (1995)
- Casting : Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight
- Scénario / adaptation : Michael Mann, remake de son téléfilm L.A. Takedown
- Le Pitch : À Los Angeles, un braqueur de génie, Neil McCauley, prépare un dernier coup. Un policier obsessionnel, Vincent Hanna, le traque. Entre eux, un respect mutuel, mais un destin irréconciliable.
- Box-office France : 1,43 million d’entrées
- Le grand chef d’œuvre du réalisateur : un duel de titans (Pacino / De Niro et cette fameuse scène dans un restaurant qui sanctuarise les deux stars), une fresque chorale (Val Kilmer, Tom Sizemore, Jon Voight, Ashley Judd, Natalie Portman…), le réalisme des fusillades en plein Los Angeles (encore un hommage au cinéma des 70s). Mann compose une symphonie urbaine où s’affrontent solitude, discipline et incapacité à mener une vie personnelle. Le polar devient une méditation tragique sur le prix à payer quand on est flic ou voyou. Si chacun se respecte, cela n’empêche pas le réalisateur de tracer son chemin vers une poursuite de haute intensité, où la justice et les hors-la-loi semblent jouer au chat et à la souris. Le réalisateur s’est inspiré d’une affaire criminelle des années 1960, aidé par les conseils d’un ami ancien policier. Il convoque ainsi Melville et Arthur Penn, un minimalisme qui devient sa marque de fabrique et une appétence pour des personnages complexes, voire ambivalents. On remarque surtout la grande connaissance grammaticale cinématographique de Michael Mann. Aucun faux pas. Tout cadrage est mûrement réfléchi. Jusque dans les scènes d’action, chorégraphiées comme rarement à Hollywood à l’époque. Le film rest une référence dans le genre. Une suite est en cours de production.
The Insider (Révélations, 1999)
- Casting : Russell Crowe, Al Pacino, Christopher Plummer, Philip Baker Hall
- Scénario / adaptation : Eric Roth & Michael Mann, d’après un article de Vanity Fair
- Le pitch : Jeffrey Wigand, ancien scientifique de l’industrie du tabac, révèle des pratiques criminelles. Soutenu par un producteur de télévision, il affronte la manipulation médiatique et la pression juridique.
- Box-office France : 399 000 entrées
- Le réalisateur change de registre avec un thriller moral et politique, avant qu’Hollywood n’en fasse une mode (Erin Brockovich, Michael Clayton, The Constant Gardener, Spotlight, Dark Waters…). Inspiré d’une histoire vraie, à partir d’une enquête journalistique, The Insider s’inscrit dans la lignée des grands drames dévoilant des scandales (Les hommes du Président, Le syndrome chinois, Serpico). Dans une atmosphère où l’ombre domine la lumière, avec une esthétique accentuant les poids des secrets, Mann transpose ses thèmes habituels à un héros « civil » : intégrité, isolement, guerre contre un système puissant. Les cadres géométriques – plans très rapprochés insistant sur la claustrophobie pregnante ou plans larges accentuant l’isolement – et l’usage de la lumière révèlent un monde où la vérité est assiégée et où la paranoïa fait déraisonner les caractères les plus endurcis. Une réussite formelle autant qu’un film essentiel dénonçant le cynisme du capitalisme. Soulignons enfin la performance de Russell Crowe, sans doute dans son plus grand rôle, qui incarne parfaitement un homme sous pression dans un film qui se régénère à travers des conflits humains.
Ali (2001)
- Casting : Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight, Mario Van Peebles
- Scénario / adaptation : Michael Mann, Eric Roth, Stephen J. Rivele, Christopher Wilkinson
- Le pitch : De 1964 à 1974, le film retrace la carrière et l’engagement de Muhammad Ali : ses victoires, son refus du Vietnam, sa conversion à l’islam, ses relations personnelles, jusqu’au mythique « Rumble in the Jungle ».
- Box-office France : 1,03 million d’entrées
- Pour son premier biopic, Michael Mann s’initie à un cinéma plus sensoriel et impressionniste que narratif. Mann filme le corps d’Ali comme une architecture en mouvement et inscrit sa trajectoire dans l’histoire politique et médiatique d’un pays. Là encore ce qui l’intéresse c’est le surgissement des démons et les combats d’un homme, au-delà de l’icône : il devient sujet d’un combat intérieur autant qu’extérieur. Ali est une fois de plus le symbole d’une résistance à un système. Il boxe sur les rings mais cogne l’Amérique où ça fait mal et l’envoie dans ses cordes avec son identité de champion noir, pacifiste, musulman. En ne se focalisant que sur dix années de la vie de Cassius Clay / Mohamed Ali, Mann dessine le portrait d’un homme qui incarne la contre-culture à une Amérique WASP basculant dans le désenchantement. Si le film est sans doute trop long, il dénote surtout par sa tonalité, plus proche de l’hommage solennel que de la célébration d’un géant du siècle. Il manque le feu du combattant et s’enlise un peu dans un regard trop sérieux sur l’homme. Reste Will Smith, qui trouve là une de ses plus grandes créations cinématographiques.
Collateral (2004)
- Casting : Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Javier Bardem
- Scénario / adaptation : Stuart Beattie
- Le pitch : Max, chauffeur de taxi, voit sa nuit basculer lorsqu’un tueur à gages l’oblige à l’accompagner dans sa tournée meurtrière à Los Angeles. L’un tente de survivre, l’autre d’exécuter sa mission avec efficacité glaciale.
- Box-office France : 1,45 million d’entrées
- Le plus gros succès personnel de Michael Mann tant aux USA qu’à l’international. Dans la veine du Samouraï de Melville, le réalisateur, bien avant Drive de Winding Refn, explore un Los Angeles nocturne sublimement filmé en numérique HD. Le taxi devient un huis clos roulant – coucou Jarmusch! -, la ville une jungle contemporaine et minérale. Le film oppose l’homme ordinaire et le professionnel froid, questionnant la capacité de chacun à affronter ses choix de vie. Un antagonisme qui joue sur les contrastes : classe sociale, couleur de peau et style de fringues, éthique et morale. Tout les oppose. Tom Cruise, cheveux argentés, trouve ici son dernier grand personnage à date, hors blockbuster d’action. Cette errance très « after hours » (hello Scorsese), admirablement maîtrisée par un réalisateur au sommet de son talent, en fait un polar visuellement fascinant au réalisme passionnant. Reste là encore l’absence d’humour : tout aussi froid que ses autres films, Collateral illustre bien le style Mann (solitaires, antihéros, lutte contre l’oppression ou le cynisme d’un système) tout en assumant une écriture réfléchie, presque cérébrale.
Miami Vice (2006)
- Casting : Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie Harris, Ciaran Hinds, Justin Theroux
- Scénario / adaptation : Michael Mann, d’après la série télé qu’il a produit
- Le pitch : Les inspecteurs Crockett et Tubbs infiltrent un réseau de narcotrafiquants. Mais leurs vies sentimentales et leurs identités d’emprunt se brouillent, menaçant leur mission.
- Box-office France : 1,57 million d’entrées
- Dans la plus pure tradition du blockbuster / buddy movie (L’arme fatale, Bad boys…), Mann signe un thriller fiévreux, tourné caméra au poing en numérique. Pourtant on a cette impression d’un film presque impersonnel, trop convenu dans sa forme comme dans le fond. Ressenti renforcé par le miscast de Colin Farrell, pas vraiment idéal dans le rôle de Don Johnson. Le réalisateur privilégie la sensation, la vitesse, les éclats lumineux sur fond de romances impossibles. Cette plongée dans l’ivresse du risque est peut-être le seul aspect « mannien » identifiable du film. Les flics sortent des clous et jouent avec la frontière floue entre la loi qu’ils représentent et la justice qu’ils défendent. Des lignes jaunes allègrement franchies puisque la fin justifierait les moyens, quitte à perdre sa mise. L’indistinction entre travail et vie intime condamnent finalement les héros. Une fois de plus Mann détourne le blockbuster en une réflexion sur l’impossibilité d’être pur, et qu’il n’ya rien de blanc ou noir dans ce bas monde.
Public Enemies (2009)
- Casting : Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Billy Crudup, Channing Tatum, Carey Mulligan
- Scénario / adaptation : Ronan Bennett, Ann Biderman & Michael Mann, d’après Bryan Burrough
- Le pitch : Dans l’Amérique des années 30, le gangster John Dillinger défie le jeune FBI dirigé par J. Edgar Hoover. Entre mythification médiatique et traque implacable, sa chute est inévitable.
- Box-office France : 1,54 million d’entrées
- Un Heat en costumes. Et un autre hit pour Mann (le film a attiré presqu’autant de spectateurs dans le monde que Collateral). Il filme ici Dillinger comme le dernier rebelle face à la bureaucratie moderne. On en revient donc à cette fascination pour les Robins des bois et autres résistants au Système, en l’occurence ici un FBI qui cherche à assoir son pouvoir autoritaire par n’importe quels moyens (torture, chantage, etc.). Il s’agit là encore d’une histoire (vraie) de traque entre flics et voyous, où l’on se demande lesquels sont les plus intègres. Si on note la splendide direction artistique (qui n’a rien à envier aux Incorruptibles de Brian de Palma) et des acteurs magnifiés par la mise en scène, le scénario souffre d’une rythmique en dilettante. Mais l’usage du numérique granuleux brise l’imagerie « carte postale » des années 1930 pour restituer une immédiateté rugueuse. Les scènes d’action impressionnent, une fois de plus, et offre au spectateur un spectacle immersif. En outre, le film interroge la naissance du contrôle institutionnel et la fin du hors-la-loi romantique, un peu comme le fera Soderbergh avec son Che sorti un an auparavant. Mann scelle ainsi le destin d’une Amérique où les vilains étaient charismatiques et leur parcours presque poétique à l’instar des Bonnie and Clyde et autres Badlands et Gun Crazy.
Blackhat (Hacker, 2015)
- Casting : Chris Hemsworth, Tang Wei, Viola Davis, Wang Leehom
- Scénario / adaptation : Morgan Davis Foehl
- Le pitch : Un hacker emprisonné est libéré par le gouvernement américain pour traquer une cyberattaque aux conséquences géopolitiques. La mission l’entraîne d’Amérique en Asie, au cœur d’un monde interconnecté et opaque.
- Box-office France : 144 000 entrées
- Ce polar numérique mondialisé a-t-il été incompris à sa sortie? En tout cas, le film signe le premier grand flope en 25 ans du réalisateur. Un échec cuisant qui va le mettre sur pause de longues années. Il tente de traduire visuellement les nouveaux territoires virtuels : flux financiers, données, architecture des réseaux. Mais justement, sa mise en scène rend les process techniques presque abstraits et déshumanise complèteemnt ses personnages. Le récit trop classique ne peut pas se reposer sur un scénario solide. Pourtant, tout l’univers de Mann y est, tous ses codes sont appliqués à la lettre. Sans doute trop distant et trop froid, et parce qu’il relève plus du thriller paranoïaque et psychologique que du blockbuster d’action, Hacker a dérouté les fans du genre. À cheval entre le film noir, voire hitchcockien, et le polar cyber, la réalisation ne parvient jamais à imposer ses éventuelles audaces. On en vient à ne voir qu’un film synthétisant le style Mannien et ses manies, sans jamais s’intéresser aux enjeux pourtant très pertinents (et aujourd’hui déjà dépassés).
Ferrari (2023)
- Casting : Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O’Connell
- Scénario / adaptation : Troy Kennedy Martin, d’après la biographie de Brock Yates
- Le pitch : Été 1957. Enzo Ferrari, au bord de la faillite et ravagé par le deuil, joue son avenir sur la Mille Miglia, tout en affrontant ses dilemmes familiaux et sentimentaux.
- Sortie française en VOD sur Prime Video
- Déjà producteur du percutant et bien roulé Ford v Ferrari (Le Mans 66) de James Mangold en 2019, Mann s’attaque à un emblème italien, loin de ses antihéros américains. Le cinéaste réalise ainsi son deuxième biopic, et fait un pas de côté vers le mélodrame intime. Ferrari n’est pas réellement un film de course. Mann préfère scruter l’homme derrière la légende industrielle : sa douleur, son obsession, son incapacité à concilier empire et vie personnelle (ce qui est finalement un fil conducteur de toute sa filmographie). La vitesse deviendrait ainsi le prolongement métaphysique de la perte et de la survie. pourtant lorsque les moteurs commencent à rugir et les pneus à crisser, le film retrouve un peu de l’élan spectaculaire de ses grands films précédents. Mais là encore, le scénario trop bancal, l’esthétique trop forcée, l’élégance artistique trop appuyée et sa mise en scène élégante, étouffe une œuvre inégale, maladroite, souvent didactique et hélas dépourvue d’émotions. Comme si le film restait étranger à la chaleur humaine et aux flux sanguins qui l’irrigue.