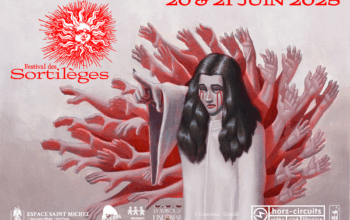Enfant de la balle (un père régisseur et souffleur, une mère comédienne), enfant sans le sou, Jacques Perrin a trouvé sa place devant puis derrière la caméra. Il a accompagné les cinéphiles durant près de six décennies. Il est mort le 21 avril à l’âge de 80 ans.
Acteur, producteur, documentariste engagé, il aura traversé tous les cinémas avec une passion rare et une audace admirable.
Jacques Perrin c’est évidemment le visage du jeune premier bellâtre et romantique qui vient à l’esprit: celui des films de Jacques Demy, douce parenthèse de sa filmographie, qui ne lui ressemblent en rien, mais à qui il doit sa postérité à travers les générations.
Le premier acte de sa vie est ainsi celui du comédien. Figurant chez Marcel Carné (Les tricheurs), il trouve un second rôle marquant chez Henri-Georges Clouzot dans La vérité en 1960. La Nouvelle vague lui échappe (il n’a pas la gueule de l’emploi), mais il trouve en France et en Italie de quoi s’imposer à l’écran. Mauro Bolognini avec La corruption lui offre son premier grand rôle. Mais il doit attendre 1965 pour crever l’écran grâce à Pierre Schoendoerffer et sa 317e section (prix du scénario à Cannes) et Compartiment tueurs de Costa-Gavras. Deux cinéastes qui vont avoir leur importance dans sa filmographie. Il passe ainsi du film de guerre (au tournage éprouvant en plein Cambodge) au film noir (avec Yves Montand en tête d’affiche).
Perrin reste très fidèle à ses réalisateurs : Vittorio de Sera (Un homme à moitié lui vaudra son seul grand prix d’interprétation, à Venise, en 1966), Valerio Zurlini, Schoendoreffer, et surtout Costa-Gavras. Cela ne l’empêche pas de s’aventurer chez Claude Chabrol (La ligne de démarcation), Bertrand Blier (à ses débuts, dans un court métrage, La grimace), Jacques Rouffio (L’horizon), Pierre Granier-Defferre (Le grand dadais), Paul Vecchiali (L’étrangleur)… Il sera aussi Colin, l’éternel héros romantique de L’écume des jours, adaptation du roman de Boris Vian.
Mais c’est Maxence dans Les demoiselles de Rochefort, moussaillon idéaliste qui part en perm à Nantes, homme rêvé de la jumelle Deneuve, qui va lui coller à l’image. Demy lui péroxyde les cheveux. Puis trois ans plus tard, en 1970, Demy lui demande d’incarner le prince charmant de cette même Deneuve, avec costumes médiévaux colorés et candeur assumée, dans Peau d’âne. Difficile de résister à l’archétype du gendre parfait, qu’il soit matelot ou noble. Rosalie Varda lui a logiquement rendu hommage : « Il est d’ailleurs le seul acteur à avoir réussi à incarner un prince dans un conte de fées. Je ne vois pas d’autres exemples. Le seul prince qui existe, qui ne provienne pas d’un dessin animé, joué par un acteur qui tient et tiendra sur des décennies, c’est lui. C’est le rôle le plus difficile qui soit. J’aime beaucoup la séquence onirique tout en blanc, où, avec Catherine Deneuve, ils font tout ce qui est interdit. Fumer, et on se demande bien quoi… Le plaisir de Demy était d’écrire pour Perrin des rôles qui ont l’air simple mais qui sont d’une modernité totale. »

Pourtant, l’acteur s’avère plus fascinant dans des films plus dramatiques et plus sombres, plus politiques aussi, au service d’une exemplarité morale et d’une justice face aux tyrans. Z, Etat de siège et Section spéciale de Costa-Gavras, Le Crabe-Tambour de Schoendoerffer. Et si depuis ce dernier, Palme d’or à Cannes en 1977, il n’ jamais cessé de tourner, il s’est fait plus discret sur le grand écran (tandis qu’il tourne une trentaine de films pour la télévision et une dizaine de séries). Il accepte des personnages secondaires mais impeccablement joués chez Margarethe Von Trotta, Yves Robert, Christophe Gans, Xavier Beauvois et récemment Frédéric Tellier (Goliath), ou chez son neveu Christophe Barratier (Les choristes, Faubourg 36). Et c’est d’ailleurs dans un second-rôle qu’il marque une dernière fois la mémoire des cinéphiles : en cinéaste amoureux du cinéma, les larmes aux yeux face au grand écran, dans Cinema Paradiso (1989).
Car Jacques Perrin n’est pas qu’un acteur. Par hasard, il a du se lancer dans le métier de producteur. C’est le deuxième acte de sa vie. En 1968, il produit Z de Costa-Gavras, primé à Cannes et oscarisé (meilleur film en langue étrangère). Le financement américain du film a fait défaut et Perrin se lance dans le projet, sans aucune expérience. Reggane Films, devenue par la suite Galatée Films, va connaître autant d’échecs que de réussites. Etat de Siège, Section spéciale, Le désert des tartares : il coproduit d’abord des films où il est interprète et qui trouvent difficilement des financeurs. En 1976, il coproduit également le premier film de Jean-Jacques Annaud, La victoire en chantant, qui lui vaut son deuxième Oscar du meilleur film en langue étrangère. Avec Les quarantièmes rugissants de Christian de Challonge, il frôle la banqueroute et met une décennie à rembourser ses dettes.
Il abandonne la fiction pendant un certain temps pour se lancer dans le documentaire, principalement animalier. Il utilise des nouvelles techniques de tournage, privilégie le spectaculaire, investit dans le temps et veut révolutionner le genre, jusqu’à être aujourd’hui copié partout. Cela donne Le peuple singe, Microcosmos, immense succès international, Le peuple migrateur, Océans, qui obsolète les docus de Cousteau et remporte deux César, L’odyssée du loup… Côté fiction, il s’enrichit grassement avec Himalaya : l’enfance dun chef, pari risqué, Les choristes (mais il perd de l’argent avec un autre film de son neveu Christophe Barratier, L’outsider). Il se refait une santé avec une fiction familiale grandeur nature, Mia et le lion blanc.
Les animaux et les grands paysages lui auront porté chance. Sa fibre écologiste, engagement inaltérable et sans concession, fera de lui un précuseur dans ce domaine dans le cinéma mondial.
Car pour atteindre ses rêves fous, avec ulm, nouvelles caméras et tournages au long cours (parfois cinq ans), Jacques Perrin se donne les moyens. Jusqu’à devenir réalisateur de ses propres documentaires. C’est le troisième acte de sa vie.
Comédien toujours juste, producteur ambitieux, il est aussi un cinéaste qui laisse une trace dans le genre documentaire, amoureux des belles images, traquant l’événement rare, sachant raconter une belle histoire tout en essayant de transmettre simplement sa fascination pour le vivant. Il débute avec un film de montage, hommage au cinéma français, sur une musique de Michel Legrand (la musique est toujours primordiale dans ses films), Les enfants de Lumière. Il enchaîne ensuite avec Le peuple migrateur, sur les oiseaux, et adapté en série sous le titre Les ailes de la nature, Océans, sur le peuple marin, L’empire du milieu du sud, sur l’histoire du Vietnam à partir d’une tonne d’archives, et Les saisons, film requiem de 2016, autour des forêts européennes et de leur Histoire.

Jacques Perrin avait encore plusieurs projets en cours (deux fictions et deux documentaires). La foi du cinéma chevillée au corps. Car, on retiendra de lui, qu’il soit acteur, producteur ou réalisateur, qu’il était un artiste engagé, jusque dans des combats impossibles, au nom d’une certaine idée du pouvoir de l’image et du son (la muisque évidemment, les bruits de la nature, sa voix de narrateur).
En cela l’âme poète que Jacques Demy lui a offerte dans leurs deux films n’est pas si éloignée de sa carrière : celle d’un funambule qui espère toujours que ça ira mieux dans ce monde chaotique et destructeur, celle d’un idéaliste héritier des lumières (du cinéma) combattant les armées de l’ombre, celle d’un aventurier de l’amour, prince ou matelot, préférant être un saltimbanque libre qui admire oiseaux et poissons, les vagues et les nuages. Rimbaldien, il déclarait il y a six ans : « Ce bien-être que nous cherchons, il nous est donné par la beauté du monde. L’observer, la contempler, c’est un principe de régénération, comme l’oxygène.«