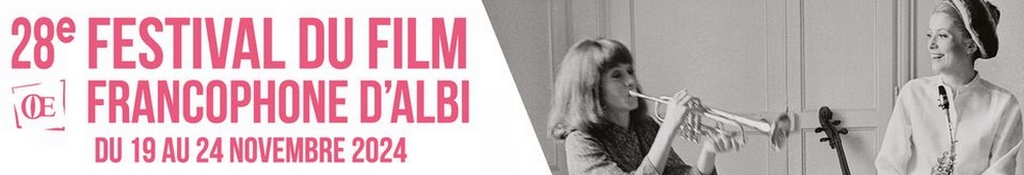
Vingt Dieux n’en finit plus de séduire jurys et publics depuis sa présentation à Un Certain Regard au Festival de Cannes, où il est reparti avec un Prix de la jeunesse. Au Festival d’Angoulême, il s’offre le Valois de diamant et le Valois des étudiants. Et en octobre dernier, il reçoit le prestigieux prix Jean Vigo. Cette « dramedie » jurassienne de bagarres, d’amitié, de romance dans le foin et de fromage conquiert les cœurs, que ce soir au Canada, en Allemagne, en Lituanie, en Espagne, ou en Inde…
Le Festival du Film Francophone d’Albi en a logiquement fait l’un de ses événements. La scénariste et réalisatrice Louise Courvoisier nous a accordé un long entretien.

Ecran Noir : Durant la préparation de ce film, est-ce que vous avez été face à des réactions hésitantes notamment de la part des financiers ?
Louise Courvoisier : J’ai eu certains rendez-vous un peu difficiles pendant la recherche de financement, je me suis trouvée face à des réactions d’interlocuteurs à Paris qui avaient déjà plein de clichés ou d’idées reçues sur la campagne. J’ai pu entendre des choses comme « ça dans les campagnes ça ne se passe pas comme ça » et moi je disais « si, si c’est comme ça« , car c’est l’environnement que je connais et où j’ai grandi.
Par exemple pour ce qui est de l’alcool en conduisant. Il y a toujours des accidents en voiture ou en moto à cause de l’alcool, ça a fait partie de mon quotidien autour de moi. C’est étonnant de se confronter à des interlocuteurs qui avaient une représentation de la campagne sans avoir jamais habité là-bas et qui étaient certains de mieux connaître ce qui s’y passe. En fait ce qui est difficile c’est qu’on a tellement besoin de ces partenaires financiers qu’on ne peut pas ne pas écouter leurs remarques ou leurs craintes à propos de ci ou de ça dans le scénario. Mais c’est important de ne jamais perdre de vue le film qu’on est en train de faire. Il faut écouter les retours et les contraintes qu’on nous donne et qui ne sont pas toujours dans l’esprit du film qu’on a envie de faire. Et puis finalement, il faut quand même garder le cap sans rien changer. Ces retours ne devaient pas emmener le film ailleurs, et je me suis vraiment accrocher à l’idée du film tel que je l’avais en tête.
Pour ma région, c’était tout l’inverse, ce projet de film a été plutôt bien soutenu, ça a été plus facile. J’avais un très bon entourage et les gens me connaissaient bien. En fait tout a été tourné dans un rayon de 20 kilomètres autour de mon village.

EN : Dans un premier long-métrage il y a forcément des choses plus difficiles que d’autres à mettre en images. Il y a d’ailleurs plusieurs scènes de bagarres un peu brutales mais aussi plusieurs scènes avec peu de dialogues entre Totone et sa petite sœur ,où tout passe par les regards… Qu’est-ce qui était le plus difficile à mettre en scène ?
Louise Courvoisier : Il y a eu beaucoup de choses très difficile à tourner mais qui ne se voient pas forcément quand on est devant le film en tant que spectateur. On a l’impression que presque tout est naturel, et tant mieux, mais en fait, ce n’était pas du tout facile à réaliser. Les scènes de bagarre c’est compliqué, les scènes de motos c’est très compliqué, mais ce n’est pas du tout le pire. Les scènes d’intimité c’est quand même technique et difficile, surtout avec des acteurs non professionnels. Parfois ils sont juste deux dans une pièce et ce sont les scènes sur lesquelles j’ai le plus cogité. J’ai fait beaucoup de travail de préparation pour arriver à savoir qu’on allait ‘avoir la scène’. Parce que si on arrive sur le tournage sans avoir vraiment préparer, on se laisse dépasser.
Je pense que les scènes les plus difficiles à tourner ont été celles du vêlage ( la naissance d’un veau, ndlr) et celle de la course de voitures de stock-car. En plus, ces séquences ont un impact important.
Le vêlage c’est tellement d’inconnues incontrôlables qu’il ya beaucoup d’enjeu et beaucoup de stress. Pour la course des voitures de stock-car, il se passe un peu tout en même temps avec de nombreuses interactions entre les personnages. Il y avait des choses très fines à mettre en place dans un décor où il se passe beaucoup de choses. Il y a des réconciliations avec de l’émotion et je voulais qu’on la ressente. Mon ambition était un pari : celui que le spectateur comprenne ce qui se joue entre les personnages alors qu’ils ne se parlent pas.
EN : Il y a eu d’autres moments compliqués à tourner?
Oui. Une autre grosse séquence difficile à faire c’est celle du bal où j’ai été très gourmande en mise-en-scène. Là aussi il se passe tout en même temps dans un espace où il y a beaucoup de figuration en arrière-plan. Il ne fallait pas perdre les enjeux de cette longue séquence. Il fallait être extrêmement bien préparé. Je me rend assez facilement compte de tout le travail à faire, et du coup je prépare, je prépare, je prépare. Hors de question de subir un ‘trop tard’ ou un ‘tant pis’ pendant le tournage. Jors de question de mettre tel figurant ici car on on n’en a pas d’autre là.
Pour une scène plus simple avec Marie-Lise et Totone en face à face et qui se parlent dans la paille, j’avais imaginé un long plan-séquence. C’est aussi une difficulté. C’est presque anodin car il ne se passe pas grand-chose, ça pourrait être facile car c’est juste deux personnages dans un lieux pas compliqué pour filmer. Parfois il y a plus d’enjeu quand il n’y a que seulement deux personnages que quand il y a cent cinquante personnes dans l’image. Mais j’ai mis beaucoup de temps à la trouver cette scène, je la trouvai fausse et donc je l’ai répétée de nombreuses fois jusqu’à avoir l’idée de les mettre face à face ce qui a vraiment débloquer la scène dans ma tête. C’est alors que j’ai eu cette idée de plan-séquence qui m’a permis de rythmer à l’intérieur du plan cet échange. Et c’est là où j’ai trouver la justesse de la scène. La mise en scène c’est trouver qui est placé où, comment on traite l’espace et à quel moment de la scène on arrive. Est-ce qu’il rentre dans la pièce ou est-ce qu’on est déjà dans la pièce? On ne peut pas se reposer sur un ‘de toute façon il se passera quelque chose‘. Il faut que ce qui se passe soit vraiment bien, il n’y a pas d’autre option.

EN : Le jeune Totone passe par plusieurs sortes d’apprentissages, que ce soit avec la sexualité ou la fabrication du fromage. Et dans les deux cas, il est beaucoup guidé par des femmes…
Louise Courvoisier : Pour chaque personnage, j’ai réfléchi au genre. Quel intérêt si c’est un homme ou si c’est une femme? Je n’ai rien laissé au hasard, là non plus. Les rôles de femmes sont des personnages-clé dans le parcours de Totone, et ça s’est fait assez naturellement. Et en effet, j’avais envie de soigner mes personnages de femmes tout comme les personnages secondaires. Ceux-là sont durs à faire exister, à faire incarner. À l’écriture, certains étaient moins bon sur le papier. Maisune fois que les interprètes ont été choisis, les caractères se sont déployés. Notamment pour la femme fromagère qui va aider Totone. C’est l’exemple de rôle où j’avais hésité à mettre un homme ou une femme, mais j’avais envie de voir une femme dans cette activité très physique. Mais je ne voulais pas d’une figure maternelle et protectrice. C’est vraiment le casting qui a débloqué ça.
EN : Pourquoi précisément ce titre Vingt-Dieux ?
Louise Courvoisier : Ça n’a pas été toujours ce titre là, au début, pendant un moment, c’était Totone. Après être arrivée à la deuxième ou troisième version du scenario, j’ai eu besoin de changer de titre pour remettre un petit peu de fraîcheur dans l’écriture et aussi me donner l’impression que j’avais avancé sur une nouvelle version. Comme c’est un film de territoire, je trouvais ça joli de mettre une expression locale en titre mais avec cette orthographe (et pas celle de vin dieu). Vingt dieux c’est une expression qui est souvent utilisée un peu partout, mais j’ai l’impression que ça a plus traversé les générations chez nous dans le Jura. Ailleurs c’est une expression des anciens, mais dans le Jura les jeunes le dise tout le temps.

EN : Il y a un personnage un peu différent des autres, c’est la petite sœur qui parle peu et qui observe beaucoup. Elle est presque une sorte de baromètre qui comprend sans juger les actions de son frère. Un peu comme vous ?
Louise Courvoisier : Oui c’est vrai, elle est très observatrice dans l’histoire, mais dans la vie aussi et c’est pour ça qu’elle dégage vraiment ça dans le film. Elle a un regard tellement profond et perçant qu’on saisit d’emblée qu’elle capte plein de choses autour d’elle. Et ça c’est important. Cette petite sœur a une sorte d’intelligence d’observation dans l’histoire. Elle connait très bien son frère. On arrive à voir à travers elle à quel moment ce qui se passe est habituel et a quel moment c’est nouveau. Vers la fin on a l’impression que Totone retombe dans une espèce d’abandon de confiance en lui, mais c’est elle la petite sœur qui le remonte sur pieds, car elle le connait assez bien pour sentir ce qu’il faut faire à ce moment là. Elle a souvent une longueur d’avance sur lui, elle est à la bonne place pour ça. Vous avez remarqué qu’lle est tout le temps là, dans presque toutes les scènes?Elle a vraiment vécu tout ça. Et puis, à la fin, elle est prête à être le moteur de l’histoire.
EN : Vous étiez dans quel état d’esprit pour la première projection à Cannes. Et a-t-il changé, maintenant que vous avez reçu le Prix Jean Vigo ?
Louise Courvoisier : Quand je suis arrivée à Cannes je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer. J’étais dans une sortie d’inconscience. Pour moi, je croyais que c’était la fin du parcours. C’était comme la fin d’une première aventure, faire ce film a tellement été un marathon que, en quelque sorte, ça se terminait là. Je n’avais pas compris que Cannes était le début de quelque chose de nouveau, que les gens allait donner leur avis sur le film, je n’avais rien anticipé. Heureusement, ça s’est bien passé. C’est quand même quelque chose d’être à ce point là exposée. Depuis je rebondis au fur et à mesure des bonnes surprises. Ça aide a donner confiance. Je ne suis pas quelqu’un qui projette beaucoup sur la suite, je ne suis pas stressée sur des attentes et je prend les choses comme elle viennent.
EN : A Cannes, et ça a été souligné aussi au Œillades d’Albi, il y a beaucoup de premiers films français qui sont en fait parmi les meilleurs films de l’année. Je pense à Les Fantômes de Jonathan Millet, Rabia de Mareike Engelhardt, L’histoire de Souleymane de Boris Lojkine, et le vôtre …
Louise Courvoisier : Je ne m’en rend pas vraiment compte. Chaque année de nouveaux talents arrivent. Je n’ai pas cette vision globale de l’année car il y a encore certains films que je n’ai pas encore vu. Mais en effet je croise tous ces cinéastes. On se suit un peu les uns les autres dans plusieurs festivals où nos films sont sélectionnés. Maintenant j’en connais certains, on s’accompagne un peu dans cette expérience, on a l’impression d’être un peu une petite équipe. Mais je pense que les autres ont plus de recul par rapport à tout ça que moi.
EN : Maintenant que Vingt Dieux va sortir en salles, quel regard vous avez sur votre film après l’avoir vu des dizaines et des dizaines de fois ?
Louise Courvoisier : Je n’ai pas l’impression d’avoir été dépassée par mon film! Et c’est facile de l’être car c’est tellement dur qu’on peut vite faire des compromis qu’on peut regretter. Il y a forcément des petites choses du scénario qui ont changé avec le casting et pendant le tournage par rapport à mes images mentales, mais elles ont évolué au fur et à mesure de la fabrication donc je n’ai quasiment aucun regret. Le film est très fidèle aux intentions profondes de mes envies.




