Après deux années en ligne, le festival de courts métrages d’Oberhausen (Allemagne) a enfin pu renouer avec l’expérience de la salle à l’occasion de sa 68e édition qui s’est tenue du 5 au 9 mai. Et si l’on avait été durablement marqué par le compétition internationale proposée en 2020, même découverte dans la solitude d’un écran d’ordinateur, en pleine sortie de confinement (voir notre article), il est évident qu’assister à l’événement « en vrai », au milieu d’un public nombreux, bouillonnant et passionné, apporte une couche de sens et de plaisir supplémentaires.
D’autant qu’à Oberhausen, le cinéma prend une toute autre ampleur, en revenant aussi souvent que possible aux fondamentaux d’une projection analogique, mais aussi en débordant du cadre du simple écran pour se transformer en happening ou performance. Pas étonnant pour un festival qui met en lumière tout un courant dans lequel le cinéma devient fréquemment le sujet principal des oeuvres, dans une démarche méta qui interroge les supports et les techniques, renverse les codes, et réfléchit, encore et toujours, à ce qu’est l’acte de faire des films.
On a ainsi pu découvrir le 3e (et malheureusement dernier) volet d’une expérience née à Oberhausen, et confiée au réalisateur et artiste visuel finlandais Mika Taanila, joliment intitulée Conditional Cinema. Difficile à définir de l’aveu même du principal intéressé, ce programme s’est efforcé de présenter sur plusieurs éditions des films (à la fois numériques et analogiques) qui « essayent méticuleusement de réduire leur expression au strict minimum ». L’idée de condition est ici entendue comme « quelque chose qui dépend des conditions cinématographiques présentes », laissant un vaste champ au passionnant jeu des « et si… ? »
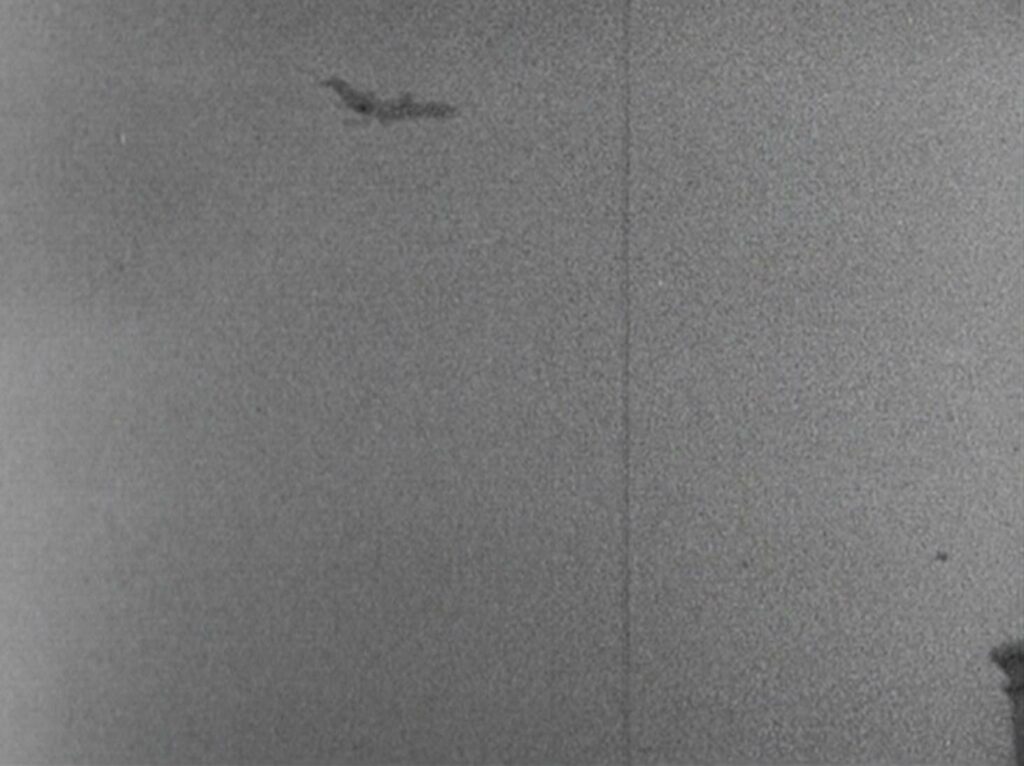
Cette année, l’un des trois programmes présentés était ainsi consacré à la météo (Weather conditions). En écho à Regen de Joris Ivens et Mannus Franken (1929) qui capte des scènes de pluie à Amsterdam (reflets et motifs géométriques dans l’eau, gouttières qui s’écoulent, fenêtres et trottoirs mouillés), étaient présentés des films s’attachant à filmer le vent (Wind de Martin Putz), le brouillard (Fog de Inger Lise Hansen) ou encore les nuages (Clouds de Peter Gidal), et à capter la manière dont nous ressentons ces phénomènes naturels presque triviaux. Le clou de la soirée était probablement la projection de Set de Peter Miller (photo de bandeau), un film de found footage recréant un coucher de soleil « global » à partir de milliers de photographies de couchers de soleil juxtaposées les unes à la suite des autres. Depuis la salle, le réalisateur projette en parallèle un « soleil’ de lumière sur l’écran, qui suit lui aussi une courbe descendante, jusqu’au crépuscule qui laisse place à l’obscurité.
Qu’il fasse nuit dans une salle de cinéma, c’est plutôt courant. Qu’un soleil y brille de mille feux, voilà qui est moins fréquent, et amène la « recherche météorologique » du programme à son paroxysme. Car bien qu’il n’y ait rien de plus évident dans nos vies que la présence rassurante du soleil qui nous éclaire quotidiennement, sa simple apparition dans un lieu inhabituel a immédiatement quelque chose de fascinant et de magique. C’est finalement la même chose pour les autres éléments météorologiques capturés dans les autres films : banals, et soudainement sublimés par leur projection sur grand écran. Comme le souligne Mika Taanila au sujet du film Clouds, ces oeuvres ne montrent pas d’êtres humains confrontés aux aléas météorologiques, elles créent une situation dans laquelle des êtres humains (les spectateurs) regardent ces manifestations de la nature, et les considèrent soudainement comme des sujets à part entière.

On pourrait se laisser prendre par le titre du dernier programme de la section Conditional cinema : Human condition. Mais loin de remettre l’humain au centre, il entend l’évacuer, pour le remplacer par des plantes, des formes abstraites ou encore… Bambi. Les robots aspirateurs de la performance intitulée I am stuck (par Mika Taanila) sont presque ce qui se rapproche le plus d’une conscience humaine. C’est à leur hauteur que l’on redécouvre la salle de cinéma, autrement dit au ras du sol. Le dispositif, qui consiste à projeter en temps réel sur l’écran les images captées par les deux personnages lancés dans leur ballet ménager (pieds des spectateurs, recoins de la salle, allée centrale), incite également le spectateur à regarder vers le bas (ce qui n’arrive jamais dans une séance traditionnelle) puisqu’une partie du film s’y déroule. Le dialogue entre les deux robots et l’appareil qui semble être leur superviseur contribue évidemment à créer un effet à la fois comique et profond. Les appareils partagent leurs doutes et leurs inquiétudes, mais aussi leur fatigue et leur frustration face à leur tâche de nettoyage. On ressent pour eux une empathie d’autant plus forte que nous sommes littéralement ceux qui leur compliquent la tâche (en salissant, en posant nos affaires sur leurs trajets, en laissant de potentiels déchets…)
Le film joue également avec le cinema en tant que lieu (temple, pour certains quasi sacré, d’un rituel ô combien immuable) et en tant que concept, en reposant intégralement sur des images aléatoires, différentes à chaque séance, et déconnectées de toute idée traditionnelle de mise en scène. C’est une expérience saisissante, à l’image du reste de la séance qui se clôt sur Tütarrakk de Pibbe Kolka (tourné avec une caméra PixelVision créée par FisherPrice dans les années 80, à destination des enfants) dans lequel la réalisatrice accomplit elle-aussi une forme de rituel au milieu des spectateurs, dialoguant avec son film, et projetant sa propre silhouette sur l’écran. C’est, explique-t-elle, « une manière d’encourager le public à être là ». Comme un personnage qui sortirait de l’écran pour poursuivre le processus entamé : un dialogue intergénérationnel à travers le temps.

Enfin, impossible de ne pas citer un autre temps fort offert par la section Celluloïd expanded qui mettait à l’honneur les performances live de cinéastes canadiens travaillant dans le cadre de laboratoires auto-gérés, c’est-à-dire dans lequel les artistes ont la main sur toutes les étapes de la création. Entièrement libres tout au long du processus, ils peuvent expérimenter au sens premier du terme, jouant avec les supports, détournant les outils à leur disposition et réinventant les usages. Leurs films continuent d’évoluer au fil des représentations et proposent à chaque fois une expérience visuelle et émotionnelle différente, qui s’adapte aux lieux et aux circonstances.
Ainsi, Karl Lemieux a-t-il interprété en direct sa pièce Yujiapu d’une durée de 30 minutes, sur 6 projecteurs 16mm, et accompagnée par la bande-son elle-aussi live de BJ Nilsen. Le film a été tourné en Chine, dans la ville fantôme de Yujiapu, projet immobilier ultra-moderne laissé inachevé pendant des années. A l’écran, le réalisateur joue des motifs géométriques des lignes des immeubles et des quadrillages des fenêtres toutes identiques pour créer une oeuvre abstraite hallucinée, aux tons dominants de noirs, de blancs et de rouges, dans laquelle les images se superposent et se multiplient jusqu’à saisir intrinsèquement l’impression de désolation de cette absurde coquille vide. BJ Nilsen utilise des sons également récoltés sur place, qu’il combine et distord dans des vagues grésillantes et obsédantes qui accentuent l’impression de démesure et de vertige. C’est là encore une expérience unique qui rebat les cartes d’un cinéma numérique prétendument hégémonique.
La performance offre en effet un espace de liberté artistes qui cherchent à exprimer autrement les sensations et les idées qui les habitent. Via la création en direct, ils peuvent faire jaillir d’autres termes cinématographiques, d’autres collisions visuelles, et expérimentent à la fois l’outil et le langage cinématographiques, dans la lignée des cinéastes d’avant-garde. Ils rappellent ainsi que rien n’est plus important que de réinventer sans cesse l’art ancestral de la projection d’images.
Ces séances sont en cela emblématiques de la démarche propre au Festival d’Oberhausen qui met à l’honneur les films et les auteur·e·s qui détournent, cherchent, expérimentent ou inventent, et qui ont en commun de se démarquer d’une production actuelle principalement centrée sur des questions de narration et de distribution commerciale, et donc fatalement contrainte à évoluer dans un cadre éminemment plus strict et balisé, qui même s’il n’exclut pas une certaine forme de créativité et d’audace, ne peut s’autoriser tous les chemins de traverse propre au cinéma de recherche, de laboratoire ou d’expérimentation.




