Cette année, Les Rencontres de la photographie d’Arles mettait en exergue le cinéma, mais pas seulement. De Los Angeles à Téhéran, de l’Amazonie à la Camargue, de Catskill à l’Inde, le tour du monde est enthousiasmant. Bien sûr, on regrette que quelques expositions ne soient pas plus attentives à l’accrochage ou aux tirages. Certes, tout n’est pas égal, ni forcément original. Cependant, la photographie est un art riche, qui se remet en question, qui s’interroge sur le monde, qui s’inspire d’autres arts ou y puise de nouvelles techniques. Si le cinéma et la photo font ici bon ménage, c’est avant tout l’image dans tout son éclectisme qui séduit (à défaut de provoquer ou d’interpeller). Et peu importe si ce sont des images analogiques et argentiques du passé ou celles recomposées par un logiciel, des archives ou du reportage, de la mise en scène ou de l’animation.
Agnès Varda : triple exposition
En attendant « Viva Varda! » à la Cinémathèque française, la cinéaste est trois fois à l’honneur à Arles. Dans le phallique bâtiment de la fondation Luma, on retrouvait son exposition de tournesols et de patates. Entre installations contemporaines et archives, c’est en tant que photographe, réalisatrice et artiste visuelle que Varda se dévoile à travers l’utopique Patatutopia et la poétique Une cabane de cinéma : la serre du bonheur.

Bien plus passionnant, dans le prestigieux cloître Sainte-Trophime, on voyageait dans le temps, du côté de Sète. « La pointe courte, des photographies au film » est une sorte de making of du premier long métrage de la Sétoise d’adoption. Après la guerre, la photographe captait la vie et les coutumes de la ville qui l’avait accueillie durant la Seconde guerre mondiale, et notamment du quartier populaire où elle tournera son premier film en 1954.
De ces planches contacts, elle en tire finalement un corpus documenté en noir et blanc qui va lui servir de matière première pour son film (qui fait écho aux photos à travers des extraits). On en retient une atmosphère, une manière de saisir les visages, un réalisme et une radicalité qui annoncent l’esprit frondeur de la cinéaste et le phénomène de la Nouvelle vague.
Enfin, dans l’exposition « Scrapbook« , le commissaire Matthieu Orléans n’a pas résisté à l’idée de montrer l’album conçu par la compagne de Jacques Demy, réalisé lors du tournage de La baie des anges. Tout s’entremêle – cinéma, littérature, art plastique – pour composer un conte de fée enchanté où l’amour et les rêves, les anges et les souvenirs se confondent dans un splendide ouvrage romantique.
Scrapbook : la belle découverte
Le scrapbook est un croisement entre l’album photo et le journal intime, le livre de fans avec ses collages et l’œuvre – parfois fictionnelle – illustrée. « Il peut réunir aussi bien des photographies que des dessins, timbres, cartes postales, coupures de presse ou encore des cartons d’invitation » explique le commissaire Matthieu Orléans.

Singulière et intrigante, l’exposition est une forme de cabinet de curiosités qui nous plonge dans l’intimité de cinéastes, que ce soit leurs fantasmes ou leurs obsessions.
On découvre ainsi que ces cinéastes ont été collectionneurs, archivistes, photographes, poètes ou dessinateurs. Ce sont parfois de passionnants documents pour comprendre le processus de fabrication de leurs créations ou la traduction de leurs sentiments les plus intimes. Ce composite de fictions et d’autofictions est un voyage dans les tréfonds de leurs tourments et de leurs amours où se mêlent créations, collages, textes, images provenant de multiples sources.
Un art méconnu où nous explorons les secrets de Pedro Costa, William S. Burroughs, Jim Jarmusch, Stanley Kubrick, Chris Marker, Bertrand Mandico…
Gregory Crewdson : une cinétique de film noir
Le plus captivant dans cette « méga expo » (par le nombre d’œuvres exposées), « Eveningside 2012-2022 » – est à la fin du parcours : un film nous y dévoile la méthode de l’artiste pour composer ses photographies format géant, où chaque détail est l’élément d’un puzzle géant.
On comprend alors, mieux, comment Gregory Crewdson parvient à nous immerger dans ses « tableaux » d’une Amérique oubliée, celle des zones urbaines délaissées, des pavillons de banlieue, des petits commerces vintage, des forêts où rodent la violence, des logements où planent la solitude.

Il y a une vision noire, parfois apocalyptique, souvent douloureuse, dans cette Amérique qui n’a plus rien d’un rêve. On flâne ainsi dans les univers de David Lynch, Edward Hopper, Jim Jarmusch, des frères Coen, de Wim Wenders et Jean-Pierre Melville aussi. La lumière est soignée. Le cliché évoque instantanément une nostalgie, une mélancolie, quand ce n’est pas une scène de cinéma.
Crewdson est un contemplatif sensible. Mais le regard est éminement politique, plus que poétique. La froideur amène une forme de brutalité. Et, en voyeuristes, nous sommes happés – fascinés? – par ces scènes intimes ou de crime, envoûtantes, malgré le danger qui les entoure.
Wim Wenders : clair obscur
C’est un peu court. Un peu trop court. Celui qui recevra le Prix Lumière en octobre à Lyon, propose « Mes amis polaroïd ». Soit un voyage dans le temps. Retour en 1976 avec le tournage de L’ami américain, avec Dennis Hopper et Bruno Ganz, entre Hambourg et Paris. Le Polaroïd était le seul appareil à proposer alors une photo instantanée. Le cinéaste allemand l’a beaucoup utilisé pour photographier les lieux de tournage, les répétitions des comédiens…
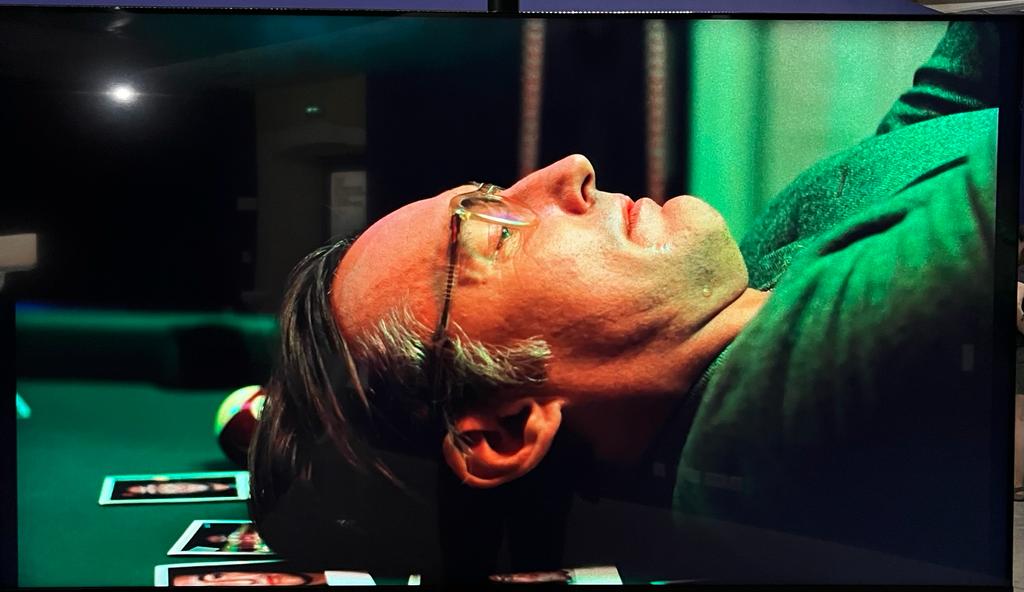
On découvre ainsi les coulisses d’un film en « fabrication ». Mais pas seulement puisqu’on revoit également la séquence du billard où le narcissique Ripley invente le selfie avec un appareil polaroïd…
Hélas, nous restons un peu sur notre faim au terme du parcours. Quelques clichés sont intéressants, mais dénués de contexte et de mise en perspective, cela ressemble davantage à un scrapbook dont on aurait décolé chaque photos pour en faire une galerie d’instants vécus.
Saul Leiter : les splendides contrastes de New York
Paris a Doisneau. New York a Leiter. Au Palais de l’archevêché, Arles offre la plus belle exposition de l’année, « Assemblages ». Et en effet, par le petit bout de la lorgnette, Saul Leiter propose une vision fragmentaire d’une métropole élégante et travailleuse, où l’ombre des gratte-ciels disputent sa place avec les rayons de lumières qui parviennent encore à éclairer ici un bout de bitume, là un passant.

Un New York Daily ou un New York Time, selon le point de vue. L’esthétique est puissante, le regard toujours distant, le mouvement permanent. Le photographe fige l’instant comme un peintre pour un tableau. Son œil semble attirer par ce qu’on ne voit pas et souligne, en creux, le chaos d’une ville et le fourmillement de ses habitants. Il a le chic pour saisir le détail invisible, mais pas indicible.
Cette vision réaliste et onirique, où le contraste du noir et blanc n’a rien à envier aux plus beaux des films, où la couleur et les reflets dans l’eau nous attirent par leur délicatesse, invite le voyeur à s’imaginer des histoires tout en s’émerveillant de la beauté qui surgit de la banalité. On est dans Manhattan et Breakfast at Tiffany’s.
Portraits : des célébrités et des mythes
Mélange d’époque. Le très beau (et très riche) musée Réattu s’ouvre pour la première fois à une collection privée, celle de Florence et Damien Bachelot. Le jeune garçon de Paul Strand nous regarde droit dans les yeux pour faire écho à l’autoportrait du jeune Réattu. Ainsi tout se répond dans l’art : la peinture et la photo, les temps anciens et les temps modernes, la couleur et le noir et blanc, les sujets et les objets.
Tapis rouge avec les danseurs d’Ann Ray (Stéphane Bullion, Nicolas Le Riche), Joseph Kessel par Irving Penn ou Jennifer Jason Leigh rougeoyante au bar Seventh Veil, captée par Nan Goldin, Picasso et Cocteau par Brian Blake, Hitchcock par Sanford H. Roth, le garçon navajo de Carl Moon…

On retrouve aussi les vedettes de ces Rencontres, Diane Arbus (maltraitée dans son exposition à Luma) et Saul Leiter (lire plus haut), des stars de la photo comme Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, James Barnor (coup de cœur de l’an dernier) et Brassaï, l’Amérique de Dorothea Lange, Louis Faurer, Mike Smith, Bruce Davidson ou Sid Grossman. Des photographes contemporains sont aussi de ce jeu de miroir : Nicolas Henry, Luc Delahaye, Thomas Boivin ou encore la série très queer de Pierre Molinier.
- Lire aussi : Arles 2022, 7 expositions à voir absolument
Et à chaque fois les collections du musée offrent une nouvelle perspective presque vertigineuse à ce dialogue entre artistes, traçant un récit particulièr d’un art comme de la manière de dépeindre l’humain dans toute sa diversité.
Une superbe histoire de la photographie à travers des portraits qui emballent les néophytes comme les amateurs et les experts. Que ce soit pour une sculpture, un tableau, une photo, on note qu’il s’agit à chaque fois d’un regard singulier et d’une mise en scène aussi belle qu’un plan de cinéma.
Paul Auster et Spencer Ostrander : de sang froid
L’écrivain et le photographe communient ensemble dans l’exposition « Pays de sang » à Croisière (en plus d’un livre publié chez Actes Sud). Ils s’interrogent sur la violence extrême qui traverse la plus grande puissance du monde. De Bowling for Columbine à Elephant en passant par We need to talk about Kevin, le cinéma s’est souvent emparé de ces massacres d’adolescents ou d’enfants dans leur école.
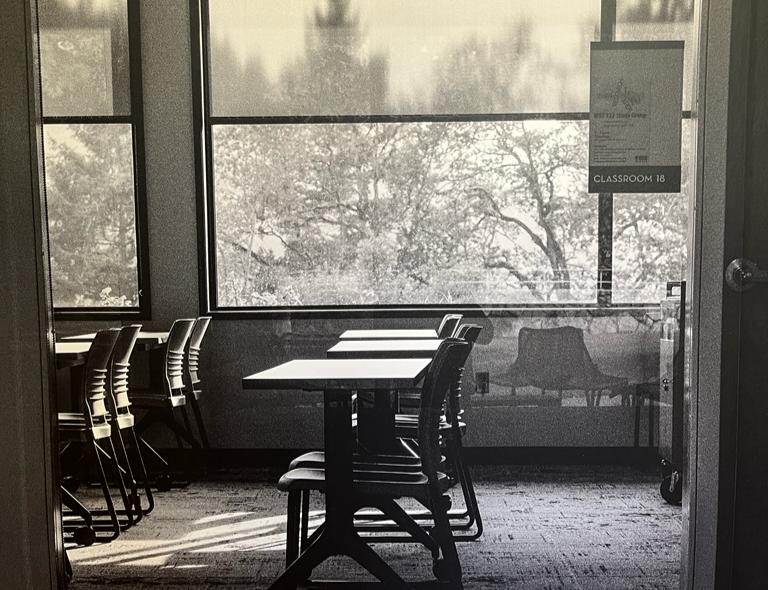
Pendant deux ans, et au fil de multiples voyages, Ostrander a posé son appareil sur une trentaine de sites de fusillades de masse. Il en reste le silence, le vide, en noir et blanc. Les humains ont disparu. Les morts sont partout, sans qu’on les voit. Des lieux inanimés. Des cicatrices à ciel ouvert. Des blessures et des fêlures palpables dans ces endroits abandonnés à eux-mêmes. Des écoles, des supermarchés, des églises… autant de symboles d’une civilisation qui sont devenus des lieux de recueillement, de deuil, d’incompréhension.
À partir de ces clichés, Paul Auster en tire des textes d’une poésie aussi froide que folle, décryptant la violence par arme à feu dans ce pays qui ne se sort pas de sa préhistoire colonisatrice. C’est clinique, glaçant, frappant. Entre ces images qui montrent les conséquences et ces textes qui analysent les causes, il y a, en creux, notre cerveau qui fait le lien et qui imagine dans cet entre-deux une culture de la mort dans toute son horreur. 100 Américains meurent de blessure par balle chaque jour. Plus de 200 sont blessés, engorgeant ambulances et urgences. Ce sont des voisins, des proches, des camarades de classe, des partenaires de sport, des collègues. Cela démultiplie le nombre de vies touchées. Impossible d’en sortir indemme.
Trois coups de cœur
Lumières des saintes (Chapelle du muséon Arlaten) et Jacques Leonard (musée Réattu) : les gitans sont à l’honneur. Il n’y a pas que Tony Gatlif qui s’intéresse à cette communauté.
Pour illustrer et documenter le pèlerinage annuel des Saintes-Maries-de-la-Mer, on peut découvrir que Lucien Clergue, Nigel Dickinson, Savine Weiss, Lore Krüger, Erwin Blumenfeld, Michèle Brabo et bien d’autres, se sont intéressés à cette procession aussi religieuse qu’artistique. Entre le sacré et l’ethnologie, les photographes ont changé de regard au fil des décennies : de la xénophobie à l’insoumission, de la liberté à l’émancipation. L’ensemble est fabuleux et majestueux et procure un sentiment de proximité (après tout, Arles n’est pas si loin) où le cultuel communautaire est devenu un rituel populaire.
Jacques Léonard, dans une veine plus humaniste et esthétique, photographe du quotidien citadin, s’est marié à une gitane qui lui a ouvert les portes de cette grande famille. Ses portraits composent un patchwork réaliste de cette culture, loin des préjugés et fait d’ailleurs écho au travail d’Agnès Varda dans l’exposition « La pointe courte ».
Zofia Kulik (Eglise des Trinitaires) : Drôle de kaléidoscope. Mais sans doute la proposition la plus originale de ces Rencontres. Voici des compositions photographiques multidimensionelles, extrêmement précises et d’apparence symétrique. Autant de complexité formée à partir de motifs, symboles, corps et objets photographiés. Ce pourrait être un tapis, un vitrail, une mosaïque, un blason. On a presque l’impression que tout cela va s’animer pour nous hypnotiser davantage.

Un jeu de pouvoir et de domination qui transcende une technique singulière avec ces immenses montages dénonçant les puissants, tout en nous soumettant à leur emprise. C’est là toute sa puissance.
Ne m’oublie pas (Croisière) : La collection de Jean-Marie Donat est unique en son genre. Les archives du Studio Rex implanté à Marseille (et aujourd’hui fermé) se croisaient les immigrés africains débarquant au port. Ils s’y font tirer le portrait. Le fonds comporte des dizaines de milliers d’images prises entre 1966 et 1985. En les compilant, cela donne un visage protéiforme et cosmopolite de ces nouveaux européens en quête de travail. On est loin des stéréotypes. Il y a ici les photographies de portefeuille, celles des souvenirs, là des photos pour les papiers administratifs, des « mugshots » d’innocents pleins d’espoir, et enfin des photos de studios, celles qu’on envoie au pays pour prouver sa réussite ou son bonheur. Une foule d’anonymes qui peuplent les cimaises et les couloirs. Après tout la photo reste avant tout un outil de la mémoire.
Les rencontres de la photographie d'Arles 3 juillet - 24 septembre https://www.rencontres-arles.com/




