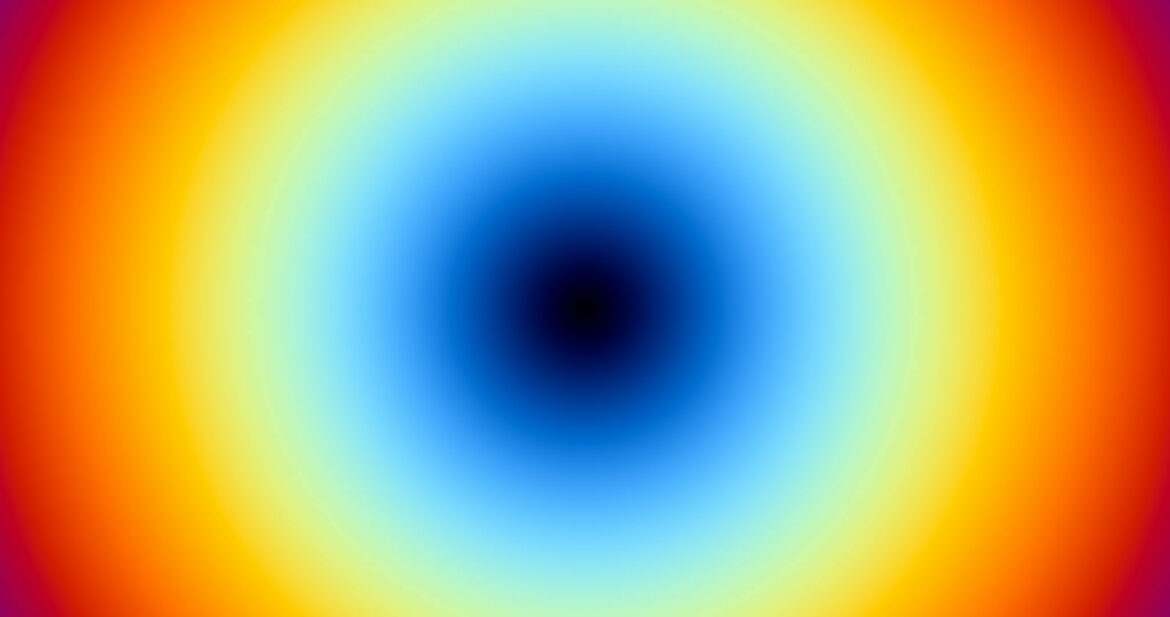L’édition hybride du Festival de Rotterdam s’est achevée avec le sacre mérité de Eami de Paz Encina, splendide documentaire introspectif et poétique sur les Ayoreos (peuple autochtone du nord du Paraguay), qui interroge à la fois des problématiques contemporaines politiques et sociales, à savoir le sort réservé aux populations natives du continent américain, et des enjeux cinématographiques liés à la manière d’embrasser le regard de l’autre sans s’exprimer à sa place.
Excess will save us de Morgane Dziurla-Petit

Un autre film présent au palmarès, quoique dans un style rigoureusement différent, proposait cette sorte d’immersion orchestrée de l’intérieur. Excess will save us de Morgane Dziurla-Petit, qui reprend et prolonge le court métrage du même nom, nous emmène à Villereau, une commune du Nord où habite la famille de la réalisatrice. Le prétexte de départ, c’est une intervention des forces anti-terroristes dans ce hameau de moins de mille habitants, suite à des sons de fusillade et des cris dans une langue étrangère.
Avec humour, le premier chapitre du film retrace les circonstances de cet événement à travers des témoignages morcelés, mis en scène sur les lieux de « l’attentat ». Comme le souligne ironiquement Faustine, la cousine de Morgane Dziurla-Petit, il manque beaucoup de choses à Villereau : une gare, un cinéma, une pharmacie, un salon de coiffure… et pourtant « [sa] famille et [ses] voisins imaginent qu’il peut y avoir des attentats« . C’est que les chaînes de télévision en continu et la banalisation des discours de peur et de haine sont passés par là.

On bascule ensuite dans une chronique familiale plus déliée, qui observe le présent en train de s’écrire, de l’organisation du mariage du père de la réalisatrice aux disputes entre frères, en passant par l’inconsolable peine du grand-père suite au décès de son épouse. Plusieurs lignes narratives viennent s’entremêler à cette trame directrice : l’une convoque les souvenirs du passé (notamment un incendie ayant dévasté une partie de la ferme familiale et causé la mort de la mère de Faustine), l’autre revient sur le succès du court métrage Excess will save us au festival de Clermont Ferrand. Et sur tout ça s’invitent les effets du confinement, le racisme ordinaire, une part de superstition, les élections municipales, du romantisme, et mille autres éléments qui forment la richesse et la fantaisie du film.
Son aspect hybride, qui se dévoile par petites touches et s’affirme frontalement dans les dernières minutes, permet de brouiller joyeusement les frontières entre la réalité et la fiction, l’humour et la moquerie, le drame et le romanesque. Morgane Dziurla-Petit joue aussi habilement avec la forme documentaire qu’avec la pure fiction, entremêlant les deux sans que l’on puisse, au premier regard, en distinguer les coutures. Elle déjoue ainsi les clichés sur ce type de films et d’émissions (on pense forcément à Strip-tease) mais aussi nos propres préjugés, et faisant mine de dévoiler un monde que l’on croît connaître par coeur, elle montre à quel point il ne cesse de nous échapper. Cela forme un résultat irrésistiblement drôle et touchant, patiné d’une mélancolie plus amère, plus introspective. Car derrière la farce se cache la réalité liée au sentiment d’être prisonnier d’un lieu qui nous conditionne, et dont il est parfois bien difficile de partir.
Silver bird and Rainbow Fish de Lei Lei

On peut, étonnamment, tisser un lien pas si hasardeux qu’il n’y paraît avec un autre documentaire, également présenté en compétition à Rotterdam : Silver bird and Rainbow Fish de Lei Lei. L’artiste chinois réputé pour ses courts métrages animés (Love, Recycled…) se plonge dans l’histoire de sa famille, dont on découvre rapidement qu’elle est intimement liée avec l’histoire de la Chine du milieu des années 50 au début des années 70. Entremêlant des extraits de conversations avec son père et avec son grand-père, il retrace différents épisodes fondateurs, souvent traumatiques, comme la mort de sa grand-mère ou le placement de son père dans un orphelinat.
Visuellement, il utilise à la fois des photos de famille et des images d’archives sur lesquelles il anime des personnages, mais aussi des figurines de plasticine qui recouvrent systématiquement les véritables visages des membres de sa famille. Cela permet d’apporter un contrepoint allégorique aux témoignages entendus en off mais aussi de porter la voix du réalisateur dans le récit. C’est à travers les séquences animées qu’il vient en effet commenter à sa façon ce qui est raconté (en appuyant parfois sur les effets d’absurdité, d’horreur et d’injustice auxquels le père et le grand-père sont trop habitués pour véritablement les souligner) et laisser libre cours à son besoin de mettre des éléments poétiques là où il n’y a que blessures et douleurs.

Certaines scènes s’avèrent ainsi particulièrement frappantes, comme lorsqu’au moment de la Révolution culturelle, une multitude de têtes en pâte à modeler sont méthodiquement écrasées et malaxées par des mains apparues dans le champ, jusqu’à l’obtention d’une unique grosse boule constituée de visages déformés. D’autres passages sont parfois plus abscons, comme lors des retrouvailles entre le père et le grand-père au bout de six années de séparation. Certains éléments restent aussi volontairement dans l’ombre, à l’image de la sincérité de la soeur aînée du père du réalisateur quand elle a dénoncé son propre père. On sent, en filigrane, les non-dits qui persistent, et les anciens traumatismes inutiles à raviver.
C’est sans doute pourquoi le film nous semble-t-il inutilement long. Pour nous, certaines digressions semblent inutiles, certaines séquences animées paraissent de trop. Mais pour Lei Lei, et pour sa famille, il s’agit d’un tout, dans lequel chaque infime détail a son rôle à jouer pour permettre d’enfin renouer avec des racines tourmentées, et apaiser, sans l’oublier, un passé qui est aussi celui de millions de familles chinoises.
The Island d’Anca Damian

Pour terminer cette déambulation dans la sélection du festival néerlandais, deux autres films d’animation nous ont laissé une forte impression : The Island d’Anca Damian et Answering the Sun de Rainer Kohlberger.
Le premier est une incroyable comédie musicale imaginé par la prolifique réalisatrice roumaine qui revient seulement deux ans après L’Extraordinaire voyage de Marona, splendide fresque humaniste à destination d’un public familial. Cette fois, Anca Damian (qui a co-écrit avec Augusto Zanovello) s’inspire de la pièce de théâtre The Island de Gellu Naum ainsi que de la pièce musicale qu’en ont tiré Alexander Balanescu et Ada Milea (qui signent logiquement la musique du film). Il s’agit d’une réinterprétation de Robinson Crusoé, dans laquelle Robinson est un médecin ayant volontairement choisi de vivre dans l’isolement (et pourtant perpétuellement dérangé sur son île pas si déserte que ça), tandis que Vendredi est le seul rescapé d’une embarcation de réfugiés ayant chaviré.
Sur cette base relativement simple, la réalisatrice tisse un récit complexe et foisonnant qui joue énormément sur les symboles (la sirène faite avec des plastiques jetés dans la mer, Vendredi qui se fabrique un costume de super-héros avec une couverture de survie, Robinson qui observe et modifie le monde grâce à la réalité augmentée…), et repose beaucoup sur la répétition, parfois jusqu’à l’obsession, de certaines phrases musicales ou de mots psalmodiés.

On n’est clairement pas dans une narration traditionnelle, mais plus dans une déambulation onirique qui fait apparaître sous nos yeux une multitude de réels, d’idées, de concepts, de moments, et donc de sensations et d’émotions. Parfois, cela va si vite qu’il n’y a rien auquel se raccrocher. On aime alors s’abandonner à cette frénésie d’images et de notes, pour revenir à ce qui est l’essence du cinéma : rythme, mouvement, couleurs, sons et envoûtement.
Bien sûr, cela n’empêche en rien de reconnaître les thématiques brûlantes que charrie le film à la façon d’un grand et beau fleuve : notre incapacité à sauver et accueillir les réfugiés, l’exploitation de l’homme par l’homme, le rapport ambivalent et même destructeur avec la nature, mais aussi la solitude et l’impuissance à agir ou simplement à se connecter avec l’autre. Cet ancrage ultra-contemporain (qui semble même avoir anticipé le covid) allié à une inventivité affranchie de toute règle donne une fresque puissante et singulière qui parvient à mêler le regard critique sur l’époque et l’atemporalité d’une poésie lancinante et hypnotique. Comme s’il prenait le contrôle sur lui-même, le film ne cesse de s’écrire et de se commenter sous nos yeux, devenant une oeuvre en perpétuelle mutation à laquelle il sera nécessaire de revenir encore et encore pour en embrasser les mille et une facettes.
Answering the Sun de Rainer Kohlberger
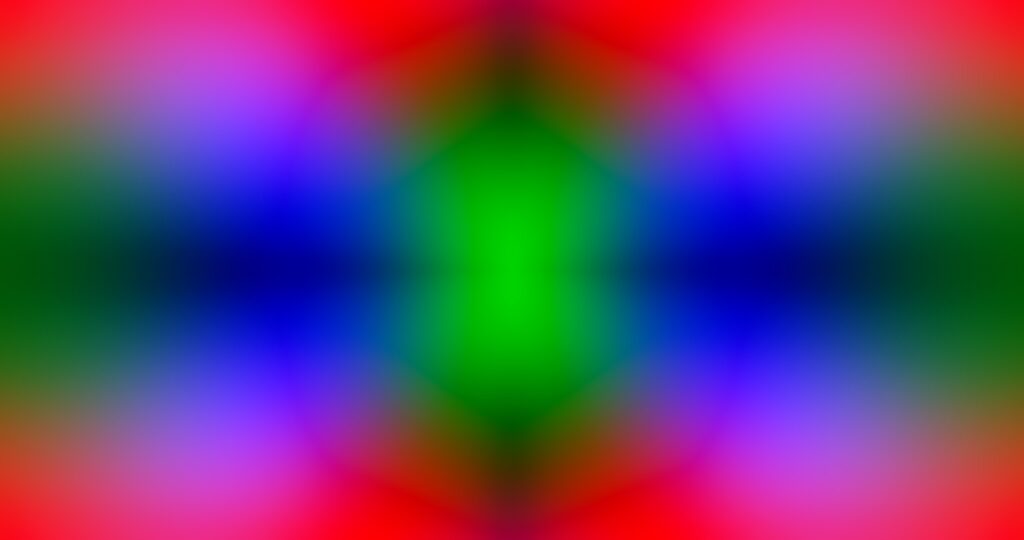
Enfin, impossible de ne pas revenir sur ce qui était probablement le plus exigeant et le plus spectaculaire film de toute la sélection 2022, cet ovni purement expérimental d’environ 60 minutes proposé par Rainer Kohlberger, qui confirme (s’il en était vraiment encore besoin…) qu’il est véritablement l’un des plus passionnants chefs de file de l’animation expérimentale autrichienne actuelle. Après notamment It has to be lived once and dreamed twice (2019) et There must be some kind of way out of here (2020), il proposait donc à Rotterdam son nouveau voyage initiatique sur les territoires énigmatiques de la lumière, de la couleur et du mouvement, une expérience totale, par nature impossible à vivre pleinement hors de l’écrin naturel de la salle de cinéma, et pourtant déjà époustouflant et sidérant dans les conditions plus précaires d’un visionnage domestique.
Peut-on véritablement décrire l’éblouissement visuel d’Anwering the sun ? On ne s’y risquerait pas. Ou peut-être uniquement par le jeu des analogies. Imaginez, par exemple, ce que ressent un simple caillou bombardé par les rayons du soleil. Ou ce que cela fait de flotter dans une symphonie de lumière. Le fait est que l’expérience est forcément unique, propre à chaque spectateur, lui-même dépendant de son propre cerveau et des images mentales qui lui viennent spontanément au fil du film et de ses effets visuels : pulsations stroboscopiques, formes géométriques kaléidoscopiques, tunnels semblant nous aspirer puis nous rejeter et autres effets de « flickering » (lorsque la surface de l’image semble vibrer d’un mouvement qui lui est propre).
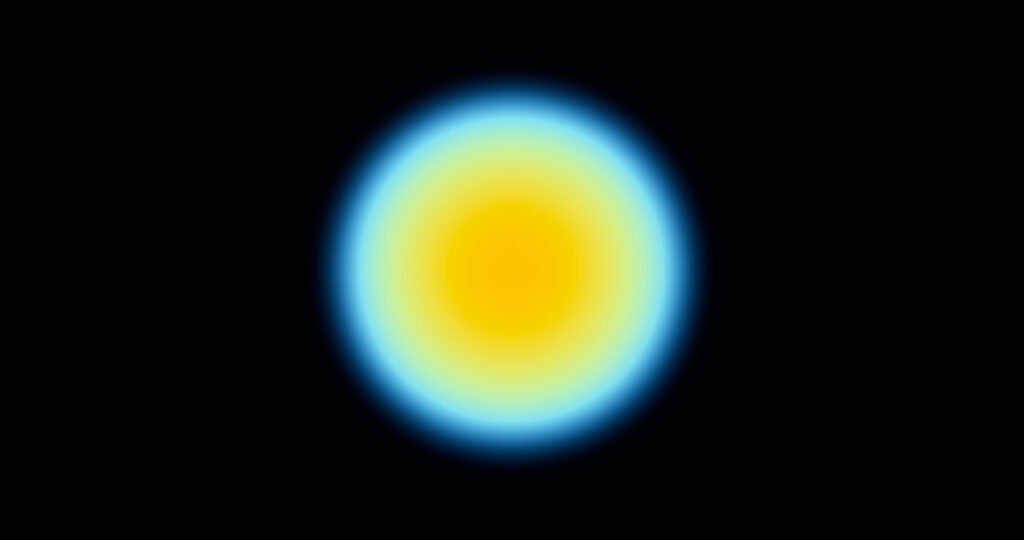
Rainer Kohlberger nous permet non seulement de regarder en face le soleil sans se brûler la rétine, mais aussi de le « toucher » dans une communion mentale d’une rare intensité. Les sensations créées par le film ne sont en effet pas seulement visuelles, mais littéralement physiques et viscérales. On ressent de l’intérieur les effets de la lumière, et ceux d’une bande son tout aussi austère et exigeante, passant de pulsations acoustiques ultra répétitives et lancinantes, extraordinairement oppressantes, à un entêtant bruissement bourdonnant.
Nous débarrassant par essence du fardeau encombrant du besoin de compréhension, Answering the sun nous plonge dans un bain de pures sensations qui nous laisse totalement libre de la manière dont on souhaite les recevoir. Il aura rarement été aussi juste de parler d’expérience cinématographique, au sens où l’on traverse organiquement le film autant que l’on est traversé par lui. Après, bien sûr, viendront les questions, qui sont autant de pistes fascinantes pour un esprit cinéphile : qu’est-ce qui relève du film en lui-même et qu’est-ce qui procède d’une forme d’hallucination ? Quelle part vient des intentions esthétiques et philosophiques du réalisateur et quelle part n’appartient qu’au spectateur ? Jusqu’à quel seuil d’abstraction ultime le cinéma continue-t-il d’exister à l’écran ? Questions que les prochains film de Rainer Kohlberger, on l’espère, ne cesseront de venir affiner et enrichir, sans jamais livrer de réponses toutes faites.