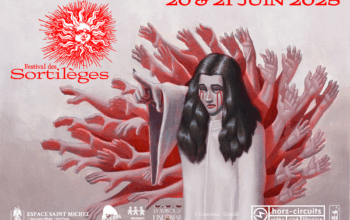Sélectionnée à la Semaine de la critique avec son premier long métrage Alma Viva, la réalisatrice franco-portugaise Cristèle Alves Meira est déjà une habituée de Cannes, où elle a présenté deux courts : Champ de vipères (dont nous vous parlions ici) en 2016 et Invisivel Heroi en 2019. Alma Viva suit la petite Salomé qui passe son été au Portugal, chez sa grand-mère chérie. Cette dernière, qui communique avec l’au-delà, l’initie à des rituels magiques. Mais sa mort soudaine provoque un cataclysme au sein de la famille comme du village.
Comment s’est articulée l’écriture d’Alma viva par rapport à vos différents courts métrages ?
Avant Champ de vipères, il y a eu un autre court qui s’appelait Sol Branco. C’était l’histoire d’une petite fille qui revient au village et se confronte à des croyances locales et au fantôme de sa grand-mère. Quand je l’ai écrit, j’avais déjà Alma viva en tête. Mon désir de cinéma initial, c’est Alma viva. Sauf que je n’ai pas fait d’école de cinéma, je ne pouvais pas commencer par un long, il fallait que m’exerce. J’ai donc réalisé ces deux courts qui sont comme un terrain d’expérimentation pour Alma viva, que ce soit le territoire de l’enfance, la question des croyances, les décors, les comédiennes… Pour résumer, avec ces films, j’ai aussi préparé les gens de mon village à accueillir un long. Le village lui-même est devenu un décor de cinéma.
On retrouve plusieurs comédiennes de Champ de vipères dans Alma viva. Il y a comme l’idée de créer une petite troupe, une famille de cinéma ?
Quand j’écrivais le long, j’avais en tête plusieurs personnages, dont celui de la tante qui s’occupe de la grand-mère. J’ai eu envie de faire un court métrage autour de cette femme qui est restée au village et qui veut fuguer. Il y avait aussi l’oncle aveugle. Comme le financement prenait du temps, j’ai décidé de faire un film avec le comédien qui l’interprète dans Alma viva, Duarte Pina, qui est un homme très inspirant. En plus, c’est un acteur non professionnel, je m’étais dit qu’un premier tournage l’aiderait à gagner confiance en lui.

C’était une évidence d’aller filmer dans ce village qui est celui de votre famille ?
Oui, c’est le village de ma mère et de ma grand-mère maternelle. Au départ, on pensait filmer dans plusieurs villages, mais avec le covid, c’était plus simple de tout centraliser au même endroit et d’impliquer les gens. On a créé comme une petite communauté autour du film. Les villageois ont tous participé : ils ont ouvert leur maison, prêté une voiture… On a vraiment fait travailler les gens de cette région. Sans leur aide et leur solidarité, cela n’aurait pas été possible. Surtout, ils m’ont fait confiance pour aborder ces thématiques de sorcellerie. Ils me connaissaient et n’avaient pas peur du regard que j’allais porter sur eux.
Dans le film, on sent qu’au sein même de la famille, il y a un choc entre ceux qui sont restés au village et ceux qui sont partis en France.
C’est un choc matérialiste parce qu’on part pour s’enrichir, et ceux qui restent ont l’impression de ne pas pouvoir s’enrichir autant. Le rapport de force est toujours lié à l’argent. Là c’était au centre de l’histoire. J’ai fait attention avec le personnage de Joachim, le fils qui a émigré en France et qui revient en exhibant sa richesse, car il était très facile de tomber dans la caricature. Je ne voulais pas critiquer ce que deviennent les Portugais qui émigrent en France. Je ne voulais pas me moquer d’eux. En revanche, je m’en amuse à travers des situations un peu cocasses qui vont leur parler et les faire réagir, comme la construction de la piscine, ou l’attitude de Joachim qui trouve que les ouvriers locaux ne travaillent pas assez vite…

On parle de matérialisme, et il y a notamment la question de l’héritage qui déchire la fratrie, avec une scène assez violente autour même du corps de la grand-mère. Comment trouver le bon dosage sur une scène comme celle-là ?
C’était une scène très difficile. Elle est là depuis les prémisses du projet car c’est une scène autobiographique. S’il y a un peu de moi dans le film, c’est cette scène : j’ai vraiment vu ma famille se déchirer autour de la dépouille de ma grand-mère. Ce choc émotionnel et ce sentiment d’injustice ont été le point de départ du récit. Donc cette scène était là depuis le début, mais au départ elle faisait 15 pages de scénario… Elle allait encore plus loin, j’en avais fait une scène de théâtre tragi-comique. Je voulais que ça tombe dans le grotesque. Après, sur la question du dosage, c’est toujours compliqué… Je sentais qu’il fallait que les deux soeurs se battent, même si ce n’était pas le cas dans la réalité. Je me suis dit que le cinéma pouvait aller plus loin. Et c’est vrai que lorsqu’on se sent mal aimé, ce qui est le cas d’une des deux soeurs, on peut en venir à cet extrême-là. Finalement, on ne sait pas si on doit rire ou si on doit pleurer, ça va loin… et c’est exactement à cet endroit que je voulais amener la scène. J’ai aussi une image des gens de cette région qui sont excessifs dans l’amour comme dans la haine. C’est en ça que je trouve qu’il y a du western chez eux.
C’est une influence que vous revendiquez ?
Pas du tout en terme de cinéphilie, mais plutôt de symbolique et d’iconographie. Il y a ces montagnes, ces terres brûlées, et puis ces litiges, ces guerres de voisinage, ces légendes… Je voulais qu’il y ait cette dimension-là dans le film. C’est quand même un sortilège qui tue la grand-mère, suivi d’une vengeance.

C’est aussi la région qui vous a inspiré la dimension surnaturelle du film ?
La magie fait partie de l’histoire que je raconte : les mauvais sorts, les sortilèges, le don de la grand-mère qui peut communiquer avec les morts, sont inspirés de pratiques qu’on peut retrouver dans ces montagnes, et plus généralement au Portugal. J’avais envie de rendre publiques des pratiques que souvent on tait, et qui se déroulent dans tous les milieux, y compris en France. Je crois que c’est l’envie de revenir à des croyances qui peuvent sembler archaïques, mais qui sont le terreau de la culture portugaise. Ce sont des pratiques documentées, et j’ai tendance à dire que le film est un peu anthropologique, car je me suis inspirée de croyances et de rituels existants.
Formellement, votre approche est plutôt naturaliste, mais avec des incursions dans le fantastique. On est dans ce que l’on appelle le « réalisme magique ». Là encore, comment cela se gère-t-il à l’écriture et au tournage ?
La question du fantastique et du genre s’est posée depuis le début. Il y a des étapes du scénario où j’allais chercher des codes du cinéma fantastique, mais ça empêchait le film d’exister dans sa nature-même. J’ai compris tardivement qu’à partir du moment où ces personnages croient et font partie de ce territoire, il n’est pas nécessaire que le cinéma vienne surenchérir avec des outils du fantastique ou des effets de mise en scène. Il était plutôt question de travailler des atmosphères surnaturelles, que cette dimension cosmique fasse partie de ce petit village par le traitement du son, de la lumière, des VFX… A travers des éléments liée au traitement de l’image, mais qui restent très réalistes, et qui s’apparentent à des références proches du conte, du merveilleux, au niveau de l’enfance, sans aller dans le film de genre. De toute façon, chaque fois qu’on a voulu en faire trop, on sentait qu’on n’était plus dans le film. Même chose avec la musique d’Amine Bouhafa : dès qu’on tendait trop vers le film d’horreur, on se disait qu’on n’était plus au niveau de Salomé. Car Salomé a peur des esprits, mais ce n’est pas Carrie. Elle est possédée, certes, mais par l’esprit de sa grand-mère adorée…. Tout le défi était de faire confiance au récit qui était plein d’éléments fantastiques, mais il n’était pas nécessaire que le cinéma le surligne.
En filigrane, il y a aussi la question de la transmission et de l’émancipation.
A un moment, je m’étais dit que le film était ésotérique car la définition de l’ésotérisme, c’est de transmettre un savoir secret. C’est ce que fait la grand-mère. Elle met aussi Salomé en garde car la communication avec les invisibles peut susciter des forces contraires. C’est d’ailleurs ce que va vivre le personnage. Il y a donc une transmission et une émancipation effectivement car quand Salomé est prise dans les filets de la sorcellerie, en quelque sorte, elle se rend compte que cela génère des forces dangereuses et qu’elle se met en danger. Elle demande à ne plus être sorcière. Elle veut s’en défaire et en même temps elle est rattrapée… Dans la scène de fin, on peut deviner qu’elle est toujours en contact avec les invisibles. Donc je crois surtout qu’elle s’émancipe parce qu’elle accepte d’assumer cet héritage, ce qui n’était pas possible pour sa grand-mère et les générations précédentes. C’est ce qui fait la modernité du film
Elle doit en quelque sorte inventer sa propre façon d’être une sorcière. Or on peut aussi y voir un parallèle avec les nouvelles générations de petites filles qui doivent trouver leur manière à elles d’être des femmes…
Je n’avais pas forcément en tête cette dimension plus politique et sociale, mais plutôt celle du conte dans lequel souvent les héros et héroïnes vivent un parcours initiatique. Ils entrent dans un territoire inconnu dans l’idée d’acquérir une autonomie. Pour moi, Salomé est un personnage de conte. Elle traverse sa part d’ombre, elle est confrontée à des événements surnaturels, elle vit ça de manière assez solitaire, pour finalement acquérir sa propre autonomie. C’est donc presque plus universel que générationnel, même si je suis très heureuse qu’on puisse le voir sous cet angle-là. Et puis il y a forcément un peu de ça puisque le film est fait en 2022 et qu’on est forcément habité par des questionnements qui nous environnent. Donc bien sûr que c’est présent, mais quand je l’écrivais, je n’y pensais pas consciemment.
Fiche technique Alma viva de Cristèle Alves Meira (Portugal, 2022) Avec Lua Michel, Ana Padrão, Duarte Pina... Sortie française : 12 avril 2023